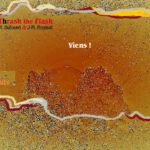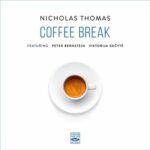Pour sa cinquième édition, Jazz(s) à Trois-Palis confirme son implantation dans l’agenda régional, avec une programmation judicieusement tuilée, faite d’ouverture et de fidélités.
La personnalité d’un festival peut se mesurer aux rituels qui se sont instaurés au cours des ans. À Trois-Palis, il y en a au moins trois, liés à la Journée du Patrimoine : la visite commentée de l’église Notre-Dame, la série de solos qui s’y dérouleront, et le concert du soir, inscrit dans la programmation d’une manifestation locale, les Soirs Bleus, qui draine un public élargi.
Un rêve créole
Cette problématique tombait à pic pour tendre l’oreille aux échos multiples qui se télescoperaient dans la musique de l’Imperial Quartet, « All Indians ? », inspirée par un territoire où s’est jouée la grande scène primitive de l’hybridation multiculturelle : New Orleans et la Louisianne. Ce quartet sans piano, reposant sur une basse aux fortes pulsations (Joachim Florent) et une batterie pétaradante (Antonin Leymarie) propulse deux saxophones en première ligne (Damien Sabatier et Gerald Chevillon) dont les voix ne cessent de se doubler, croiser, répondre en un jeu si serré, sur des cycles si brefs qu’elles n’en font souvent qu’une, jouant avec elle-même. L’esprit de la parade domine quand bien même le soliste d’un instant se laisserait emporter sur une pente plus lyrique. Glissant sur des tourneries emballées, des marches syncopées, les mélodies défilent le verbe haut, jaillissant comme des lapins de pavillons en liesse ; et lorsque Chevillon embouche à la fois alto et soprano, l’effet de chœur s’en accroît de plus belle. C’est toutefois une parade virtuose, stylisée, bouillonnante, vitaminée, non pas hymnique – à la façon d’Albert Ayler, quoi qu’on ait pu entendre plus d’une fois remuer ses cendres de phénix – mais propitiatoire. Qu’un piétinement en marque l’impatience ou qu’un dévalement soudain se ramifie en voix qui se relaient, s’interpellent, la combustion ne faiblit jamais, entretenue comme un feu roulant. Stylisée parce que, quelles qu’en soient les origines, africaines, antillaises, charentaises même, via l’émigration des Acadiens – qui sait si le branle du Poitou n’est pas discernable, enfoui sous des couches de syncopes, mêlé aux accents cajuns, de blues et de zydeco ? –, cette musique est un rêve, avec sa part chimérique, mais un rêve devenu réalité dansante et sonnante qui, par la vertu de cet entrain-là, convainc. Un rêve créole, entendu comme « construction », parce qu’il a lieu ici : une « épreuve de la créolité1 » et une main tendue – All Indians ?
L’amour des murs
Le volume de la petite église Notre-Dame, son acoustique réverbérante qui sait ne pas s’imposer pour peu qu’on se la concilie, le vivant souvenir enfin des sons qui se sont épanouis en ces murs, tout concourt à faire de ces solos un moment attendu. C’est pourquoi il sera difficile de faire admettre que 20 secondes d’écart de longitude puissent constituer un motif de retard suffisant pour l’excuser, fort marri à l’écoute des propos unanimement émus et élogieux du concert de Joachim Florent (b). Il faudra lire ailleurs ce que Xavier Prévost, Yves Dorison ou Anne Maurellet2 en ont retenu.
Suivit un autre solo de Morgane Carnet (bars, as). Initialement prévu en plein air, près du pont de la Meure : pluie de la nuit, crainte d’une averse ? l’église faisait figure de repli stratégique. Deux notes étagées comme un appel en montagne, développées en festons et volutes et amplifiées par l’acoustique, la pierre fit le reste. Des enroulements insistants, une formule répétée qui tombe sur la note la plus grave dans une acoustique flatteuse, et le tour est joué. C’est ce qu’un passage à l’alto laissait transparaître. Sur le même principe de notes ramassées comme des objets trouvés – un coquillage, une feuille, un gland –, qui arrêtent un instant un regard extasié, puis que l’on jette avant de poursuivre, bref tout ce qui aurait pu séduire lors d’une promenade bucolique, ces phrases avec arrêt sur image semblaient ici un peu dérisoires et pour tout dire sonnaient creux. L’acoustique, à elle seule, ne peut tenir lieu de discours. C’est sa limite.
Invitée à prendre un rôle actif dans le déploiement des idées et dans leur mise en œuvre, elle est l’allié idéal par lequel le discours se déploie dans une autre dimension. La musique se fait milieu. On le constaterait lorsque Daniel Erdmann (ts), le lendemain, débute son solo par la simple émission d’un souffle, grave, étiré, confié aux murs, qu’ils répondent en sculptant son volume. Un phrasé émerge alors, lent, délié, au développement méticuleux. D’un son velouté, dans un halo de brume, se dessine une ligne caressante. Balançant d’un pied sur l’autre, genoux fléchis, légèrement penché en avant, c’est dans une attitude de tendre rocker qu’Erdmann procède à une opération de tréfilage selon une imperturbable logique où l’histoire a sa part. Tandis que la réponse des murs dicte le tempo, le discours se densifie, laissant affleurer ici et là la silhouette d’un honker des temps jadis, un bopper virevoltant le temps de disparaître comme une illusion. Portées par une mélodie enveloppante des figures prennent forme, se résorbent, Webster, Gonsalvez, s’appellent librement comme s’associent des idées : toutes pointent vers l’horizon ellingtonien. Même de double-sons délicats, approchés avec infiniment de douceur, devenus des objets en soi, prennent place dans cette unique mélopée, une rêverie éveillée qui se fond dans la résonance du lieu. Des mots sont alors venus se poser sur ce long baiser, sublime, du son à la musique : Prelude to a kiss. Appelé, épelé, puis joué, amoureusement. Les lèvres prennent même le temps de se détacher du bec, le temps de recueillir le retour de la voûte puis de reprendre le libre cours de ce chant errant jusqu’à déboucher sur l’inattendu d’un plateau rythmique où s’articulent souffle et coups de langue. Cadeau de noces du temps et de la rectitude, de l’histoire en dépôt et du présent ouvert, des thèmes sont accrochés, interpolés, greffés. Ellington toujours, Ellington travaille.
Au souffle suspendu de l’assemblée tout au long du concert, on savait que ce travail n’aurait pas de fin.
Barytons
Emportés par la vague des solos, la chronologie du festival a été quelque peu bousculée. Or cette deuxième journée du 16 septembre, débutée par le solo de contrebasse de Joachim Florent verrait se succéder trois autres concerts placés sous le signe du baryton : en solo (Morgane Carnet), et en duo en deux formations aux enjeux différents.
Céline Bonacina (bars, ss) a constitué avec Laurent Dehors (cl, bcl, cbcl, cornemuse) un duo singulier quant à sa composition, ébouriffant d’invention et de virtuosité. Une quinzaine de pièces relativement courtes selon les standards du jour, présentées avec un humour distant par le clarinettiste, n’ont pas tari la verve bondissante qui les anime. La complexité des métriques, l’entrecroisement des lignes, le moirage des timbres, le courant d’énergie musclée sur laquelle elles reposent ébahit tout d’abord. La large palette instrumentale dont dispose le duo permet de varier assez les alliages pour éviter de lasser les oreilles, de même que le dispositif changeant, ici un ostinato sur lequel alternent les solos, là un épatant babillage à l’unisson (Les oiseaux, un hommage amusé à Messiaen), ailleurs un jeu tout en festons et guirlandes, une course casse-cou de dessin animé. L’exploitation raisonnée des modes de jeu étend encore les possibilités : avec ou sans bec, une clarinette est une flûte, deux instruments en bouche et le duo un trio. Quelques slaps, un peu de voix, une touche de sons enregistrés et pour finir une cornemuse à soufflet sur fond de bruit de plancher raclé, ce duo a plus d’un tour dans son sac, une panoplie de transformistes. Le baryton de Bonacina est punchy à souhait, les clarinettes de Dehors tour à tour incisives ou onctueuses, le ton emporté ou primesautier tient le lyrisme à distance, plutôt porté sur la fantaisie. Revers de la médaille, si grandes la science et l’énergie dépensées, parfait soit l’ordonnancement de ce programme, travaillée dans le détail la précision dans son exécution, trop de concertation tue la fraîcheur. La grâce s’efface peu à peu sous l’accumulation des mesures composées dont le consubstantiel défaut est de la tuer dans l’œuf. En plaçant, trop visible, la performance au premier plan, elle lui fait écran.
Baryton encore et toujours, celui de François Corneloup (bars) donnait ensuite un contrepoint à la voix d’Anne Alvaro (vcl). Un duo programmé l’an passé devenu solo suite à la défection de la comédienne, atteinte par le covid. Ce qui s’impose, dans la lecture d’un extrait de Monsieur Palomar, c’est le tempo de la diction et, ici ou là, une note fredonnée. La difficulté de l’exercice est connue. Mais l’on peut s’interroger sur le choix d’un texte qui, par sa nature exclusivement descriptive et spéculative – l’observation scrupuleuse d’un phénomène transitoire : une vague –, tend à focaliser l’attention à l’extrême, ne laissant pas la moindre chance à la musique. Si elle n’est redondante, elle devient décorative. La seule alternative possible étant d’oublier le sens, de le dissoudre en sa seule présence timbrale et syllabique. Contraint au contrechant, le baryton ne suspendit sa neutralité qu’un instant, celui d’un figuralisme où la musique s’effaçait devant l’image au lieu de la susciter. La chance d’une panne de micro par où quelque chose pouvait s’inventer dans le cours d’une improvisation ne fut pas saisie. Anne Alvaro, déstabilisée, ne sachant trop que faire de son désarroi, mit un peu en scène son impatience, puis tout rentra dans l’ordre. Par extraordinaire, il se trouvait dans ce texte à l’écriture pointilleuse une échappée qui, en tout point, anticipait ce « coup de la panne » (à se demander s’il n’avait pas été malicieusement glissé là par la régie), car Monsieur Palomar le constate : « à la fin surgit toujours quelque chose dont il n’a pas tenu compte. » Le deuxième texte choisi ne laissait guère plus de chance à l’étincelle de se produire. L’image de Beckett, par l’objectivité accordée au langage, sa langue pelée à l’os, renvoyait fatalement tout accompagnement au statut de bavardage, au mieux sans conséquence. On ne peut en vouloir à Corneloup de n’avoir pas tiré son épingle d’un jeu pipé dans lequel il n’avait d’autre rôle à jouer que celui d’un perdant magnifique.
Point, clou
Les mots, la musique, se jouent des tours, se font des nœuds, aussi s’accordent et se surprennent. Daniel Erdmann (ts) avait le matin-même à l’église, sans l’injurier, assis la Beauté sur ses genoux ; dans le même lieu, deux ans plus tôt, Robin Fincker (ts, cl) nous avait pareillement émus3 ; enfin, une quinzaine de jours auparavant à peine, Vincent Courtois (vcelle) avait trouvé à Notre-Dame le lieu idéal pour affronter en trois temps, en corps à corps et dans l’intimité, quasi incognito, l’intégrale des Suites de Bach. Trois temps très forts qui trouvaient à se récapituler pour mettre un point final au festival. Ces trois-là réunis formaient un trio au nom sans appel : Nothing else.
Des valeurs longues établissent une façon de sonner : les timbres veloutés des saxophones mariés au violoncelle s’individualisent doucement en doux frottements lors d’une ascension par paliers sur de lents trémolos contrechantés dans un esprit chambriste. Les voix se distinguent, se distribueront, circuleront d’un instrument à l’autre, en assurant une continuité et une lisibilité classiques à une improvisation de densité croissante. Au point que le moment venu de l’éparpillement en formules brèves, plutôt que de verser dans un bavardage indistinct, s’organise une superposition d’échanges où l’interjection se mue en sous-conversation. Chacun tient son couplet qu’une note tenue d’Erdmann ramène au silence. Une respiration commune aux ténors entame un deuxième mouvement dans lequel l’osmose complète entre les deux soufflants ouvre à un dialogue de chacun avec le violoncelle. Ce n’est pas même une surprise, tant le développement est organique, que surgisse alors une walkin’bass, perche immédiatement saisie pour que s’esquisse l’ombre d’un phrasé bop. Fragmenté à son tour, il débouche sur des bribes butées, des segments tirés droit donnant lieu, parce qu’un cœur unique et pulsatile anime l’ensemble, à une structure étoilée. La clarinette entre alors dans la danse sur un fond répétitif. La puissante cohésion du trio – treize années de télépathie – autorise une musique constamment protéiforme, ouverte et généreuse. Elle passe comme un souffle. Et c’est ainsi, dans un souffle, grave, à l’unisson, qu’elle s’efface. Pour un temps, comme couve un feu. Elle ressurgit d’ailleurs, le temps de s’énoncer en simple mélodie, presque une chanson murmurée par Daniel Erdmann, délicatement ourlée par la clarinette de Fincker au boisé irrésistible. Enfin, comme, décidément, la musique n’appartient à personne, un rappel verra un solo recueilli de Courtois appeler quatre notes qui passeront de l’un à l’autre, faire la navette et tisser, allers-retours, une composition filigranée, comme une image dans le tapis.
Nothing else. Un point final ? Un clou.

Philippe Alen, texte
Jean-Yves Molinari, photos
1Ainsi que l’entend Jean Bernabé : « La créolité vingt ans après » (La Créolité, vingt ans après (openedition.org)
2Xavier Prévost (Jazz Magazine) : http://urlmini.net/r/BF2ZTAK ; Yves Dorison (Culture jazz) : http://urlmini.net/r/C638NGA ; Anne Maurellet : Jazz (s) à Trois-Palis 2023 # 2 – La Gazette Bleue – le webzine d’Action Jazz (lagazettebleuedactionjazz.fr)
3Voir : Le printemps en automne – La Gazette Bleue – le webzine d’Action Jazz (lagazettebleuedactionjazz.fr)