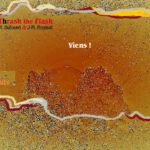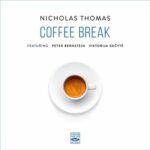Manu, cette force de la nature qui se riait des fuseaux horaires et en avait vu d’autres vient d’être vaincu par le Covid 19. Nous avions en commun d’avoir vécu in situ le colonialisme et les indépendances, la machine Singer et le phonographe. Le musicien avide de journalisme et le journaliste fada de musiques eurent donc cinquante ans de connivences. Et comme un essaim d’abeilles, les souvenirs m’assaillent. Des souvenirs toujours signés de son rire sonore. Car si pour nous la musique était une manière de passeport philosophique, elle ne pouvait aller qu’avec le partage. A ce titre, impénitent globe-trotter, Manu fut un grand partageux, un grand passeur et découvreur de talents (voir les journaux, émissions de radio, dans lesquelles il s’impliqua), outre un formidable mémorialiste, toujours plus humble à mesure qu’il avançait en âge.
Oui, même les baobabs, parfois tirent leur révérence.
En 2000, publiant chez Actes sud, « Le Swing du caméléon, musiques africaines 1950-2000), j’avais esquissé un portrait musical de notre souffleur. Il l’avait trouvé juste. Ci-joint. Avec des photos d’un autre camerounais de Douala, mon précieux complice, Bill-Akwa Betote.
Frank Tenaille
MANU « PAPA GROOVE » DIBANGO, LE PASTEUR ET SES BREBIS
De Sydney Bechet à la techno.
« Aujourd’hui, le corps, on s’en occupe en lui donnant l’habit, le frigidaire, le climatiseur, la voiture… Mais le prix d’une minute d’âme par jour, je ne sais pas ce que ça coûte ».
MD avant l’Olympia en 1991.
Janvier 1985. Korem, Ethiopie. A 3000 mètres d’altitude, un alignement de tentes. Un camp de refugiés qui abrite plus de trente mille personnes que tentent de soigner une poignée de membres de Médecins sans frontières (MSF). Il y a là des mères qui n’ont plus de lait, des hommes qui ne peuvent rien ingurgiter tant leurs muscles sont faibles, des enfants perturbés qui vont bientôt mourir. Ce sont les victimes d’une des plus terribles sécheresses que l’Afrique subsaharienne ait connues. Et c’est ce camp que visite Manu Dibango et Mory Kante, arrivés depuis Addis-Abeba dans une camionnette d’emprunt.
Si les deux musiciens ont fait le voyage, nonobstant tracasseries et absence de coopération des autorités, c’est qu’ils sont les initiateurs de l’opération Tam-tam pour l’Ethiopie, un quarante-cinq tours réalisés par de nombreux artistes africains et dont les ventes doivent être intégralement transformées par MSF en aide directe aux victimes de la famine.
« Nous ne sommes pas des politiciens, mais nous voulions montrer qu’avec nos voix, nos instruments, nous pouvions peut-être servir à quelque chose ». C’est à partir de ce postulat que Manu Dibango a mobilisé autour de lui. D’abord le gratin des musiciens africains, ensuite une série de corps de métier allant de l’édition à la distribution, enfin des medias dont la principale chaîne de télévision française.
La famine qui affecte cette année une partie de l’Afrique est sans précédent. Dans le monde, les images abruptes qui l’évoquent suscitent des actes de solidarité. Comme souvent les artistes sont les premiers à passer à l’action. En Angleterre, le collectif Band Aid réunit les stars de la pop (de Culture Club à David Bowie) et publie un quarante-cinq tour intitulé « Do They Know It’s Christmas ? ». Aux Etats-Unis, Quinçy Jones fédère pour « We Are The World » une cinquantaine des plus célèbres artistes du rock, de la variété, du jazz, de la country. En France, derrière Renaud, trente-cinq chanteurs et comédiens se retrouvent pour le maxi « Ethiopie ».
« Tam-tan pour l’Ethiopie » est avant tout l’initiative d’artistes africains, et est marqué au sceau de ce panafricanisme qui pour la jeunesse est susceptible d’offrir une porte de sortie aux problèmes qui harassent le continent. Pour marier talking-drums du Nigeria, blues mandingue, chant swahili, tempos makossa, harmonies de kora, et convier aux séances d’enregistrement des studios Davout et Acousti autant d’univers rythmiques et mélodiques, il fallait un rassembleur. Manu Dibango était la personne idoine.
Car le « Kojak » du saxo », dit « Le Grand », alias « le Vieux », pour tous les musiciens du continent incarne une autorité qui se réfère autant à une longévité que l’Afrique apprécie toujours qu’à son statut de « négropolitain » (terme qu’il aime utiliser). Personne en effet autant que lui n’a vécu, digéré, les rapports ambigus de l’Afrique avec ses musiciens, de l’Occident avec l’Afrique, de la tradition avec la modernité. Sa longue carrière, saga qui témoigne que la musique est loin d’être un fleuve tranquille, ayant fait qu’à la longue notre souffleur est devenu sinon le sage du village francophone, du moins une sorte de pasteur (référence à sa culture protestante) qui a toujours indiqué la routes à suivre.
Que n’a-t-il pas connu ce fils de Yabassi (par son père) de Douala (par sa mère) qui a connu toute l’imagerie AOF-AEF : gramophone pour écouter Tino Rossi et machine à coudre singer, cours d’orthographe dans Mamadou et Bineta et le salut aux trous couleurs ? Cet adolescent de Douala, qui a grandi entre cantiques protestants et émules de Gleen Miller dans les bars à marins avant ce long voyage vers la France au printemps 1949 dans une cabine du paquebot Hoggar (2). Cet étudiant gagné par le virus du jazz, via Sidney Bechet et Saint-Germain-des-Prés, qui, de clubs belges en maquis africains et de yé-yé en world music, surfera sur toutes les tendances musicales, laissant, à chacune de ses expériences, comme un Petit Poucet, quelques cailloux de sa quête ?
Car la trajectoire d’Emmanuel N’Djoké Dibango (né en 1933) relève du ping-pong identitaire. Ping, lorsque embauché en Belgique – où il rencontre Coco, un mannequin, qui deviendra son épouse – par le grand chef d’orchestre congolais Joseph Kabaselé, qui fut l’ami de Patrice Lumumba, il part à Léopoldville et se trouve confronté « à une configuration historique exceptionnelle » (lui dixit), celle de l’indépendance. Pong, quand après avoir monté un club dans le quartier Mozart à Douala, il doit abdiquer face aux chausse-trappes locales (de la médisance au serpent-minute placé dans sa chambre) et vérifier que l’Afrique peut avoir « la dureté du caillou ». Ping, lorsqu’aux côté de Dick Rivers puis de Nino Ferrer, il incarne l’Afro de service, statut qui renvoie aux mobilisations d’outre-Atlantique qui clament alors que « Black is beautiful ». Pong, lorsque influencé par l’art de la composition d’un Miles Davis, il imagine « Soul Makossa », mixture de rythmes traditionnels makossa et de soul US, titre qui ira en 1972 faire un tabac chez les Américains… avant que, quelques années plus tard, un Michael Jackson n’en récupère quelques mesures pour le pont de « Wanna Be Starting Something, l’un des tube de son, album « Thriller », le disque le plus vendu de tous les temps !
De fait, de par sa bi-culture, la volonté qu’il a toujours eue de composer la musique de son époque, ce rôle de précurseur, de catalyseur, « Papa Groove » l’assumera tout au long de sa carrière. Au pont de susciter à l’occasion des jalousies à propos de son étonnant itinéraire. Mais même si « ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend a faire la grimace », à postériori, son parcours en zigzag témoigne moins de rouerie que l’adaptation d’un musicien à un milieu changeant, parfois hostile. En Afrique, on prête souvent au caméléon des intentions maléfiques, compte tenu de ses capacités mutantes. Mais l’animal y est-il pour quelque chose ? Sa langue proctatile qui jaillit de sa gueule pour capturer les insectes, sa queue enroulée et puissante, sa tête casquée, ses yeux indépendants l’un de l’autre qui s’orientent dans toutes les directions et surtout sa capacité à changer de couleur jusqu’à se fondre dans son environnement témoignent de réflexes de survie, de pouvoir d’adaptation pour un animal on ne peut plus pacifique et singulier. Le musicien africain est dans une situation comparable. IL doit être un animal social doué de capacités étonnantes. Lui aussi personnifie un pouvoir occulte, celui de la musique. On pouvoir qu’on doit se concilier… ou limiter.
Ainsi l’on a souvent reproché a beaucoup de musiciens africains, un temps à Manu Dibango, d’accepter de fréquenter les puissants. Ici le président ivoirien Houphouët-Boigny qui pousse « l’hospitalité » jusqu’à faire confier à Manu Dibango la direction artistique de l’Orchestre de la télévision ivoirienne ; là, le président camerounais Ahidjo qui met une voiture à sa disposition. Mais jusqu’aux années soixante-dix, le degré d’autonomisation de la société civile permettait-il de vivre s’ils ne participaient pas à ce jeu pervers, tant les traditions de la vieille griotique avaient la dent dure ?
En 1989 dans « Trois kilos de café », Manu Dibango évoque sa trajectoire. Un témoignage à deux lectures. Celle qui désigne les étapes d’une carrière ponctuée par une vingtaine d’albums conformes à des saisons esthétiques griffées makossa, soul reggae, funk, juju, jazz, rap… et qui comptabilise ses grands succès scéniques (du Madison Square Garden à l’Olympia) et ses distinctions honorifiques. Et celle, plus secrète et plus proche de l’homme, qui dit comment ses ambitions musicales se sont heurtées aux contingences locales plus souvent qu’à l’ordinaire.
Deux albums en tout cas expriment les termes de son humanisme musical. « Négropolitaines », qui réorchestre de superbes morceaux des années cinquante à soixante-dix (dont « Indépendance cha-cha » de Kallé, « Scoubidou merengué » de Docteur Nico, « Diama lama » du prolixe Eboa Lottin, « Pata-pata » de Myriam Makeba, etc), façon de rappeler la richesse d’un patrimoine contemporain et de ses auteurs. « Wakafrica », safari musical qui met à contribution des artistes immergés dans le grand souk de la sono mondiale (Angélique Kidjo, Salif Keita, Ladysmith Black Mambazo, King Sunny Adé, Papa Wemba, Youssou N’Dour, Ray Phiri, Ray Lema…), mais aussi des musiciens comptables d’esthétiques traditionnelles à travers à travers la réadaptation de « classiques » pays. Un album voulu comme une métaphore de la réunification de l’Afrique du Sud et de celle du Nord et dont la pochette représente la silhouette d’un Manu Dibango épousant la forme du continent. Album qui, selon sa démarche, entendait fournir un début de réponse à une vieille question : « Quand se rencontrent des esthétiques différentes, quand se mêlent l’Afrique traditionnelle et l’Afrique contemporaine, qui doit faire le premier pas ? J’aime arranger, je suis amoureux des timbres, de leurs mélanges, amoureux du langage de ces musiques du terroir. C’est une langue initiatique qui concerne une ethnie, une partie de l’Afrique, mais pas tout le monde. La beauté de ce langage est si vive qu’il faut nécessairement la détourner pour l’élargir à un vaste public. C’est ce que j’ai essayé de faire avec ce disque constitué d’une forte présence de chanteurs et d’un alliage sonore plus secret ».
Quel bilan « Papa Groove » tire – t’il de toutes ces « saisons », comme on le dit pour les peintres ? Le plus juvénile des artistes africains, qui n’aime rien tant que l’atmosphère des clubs de jazz, les festivals à visage humain, de la palabre, la lecture des journaux, éclate de son rire tonitruant. Il y pensera plus tard, à moins que… « Au départ, tu fais de la musique parce que tu aimes la musique, et c’est une histoire d’amour. Puis le temps passe et c’est d’autres générations qui écoutent… Le miracle de cette alchimie, c’est dans la durée : que pour une raison ou un autre, le temps et toi soyez amis un bout de temps. A partir de là, tu te sens responsable, non plus envers la musique, mais envers les gens qui aiment la musique. De quoi exactement ? Ne serait ce que de dire à ceux qui arrivent d’éviter au maximum les erreurs que tu as faites… Et donc tu te sens un devoir de laisser une trace, non pas dans la musique, mais dans la façon d’avancer, de se comporter. Et c’est là qu’on peut parler de doyen, de sage… Tu n’as pas pensé à l’être, c’est les autres qui le pensent ».
Frank Tenaille @ Le Swing du Caméléon, Ed Actes Sud, 2000.