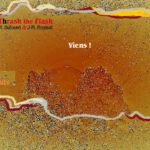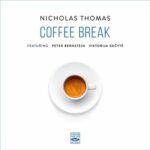Chaque parution au catalogue de Fou records propose, d’une manière ou d’une autre, une expérience du monde. Par la musique, certes, mais aussi par l’image, soit-elle fixe, imprimée, ou animée, déposée en un CD-Rom[1]. La mise en tension du son et de l’image appelle une participation qui excède la simple écoute d’un disque – à la supposer si « simple ». Mais Rêve engage plus loin encore, et il ne serait pas sage de faire l’économie de sa description matérielle un tant soit peu détaillée.Présenter Rêve comme un double album vinyle serait aussi trompeur que d’appeler « tableau » le Grand verre de Duchamp.
Sous une couverture luxueusement imprimée – un reflet vertical, torsadé et discrètement fracturé au recto ; le sol, tel qu’il peut se présenter au bout de nos souliers : feuilles, brindilles et gravier mêlés – sont glissées deux pochettes contenant chacune ce qui répond à la rigoureuse et géométrique définition d’un disque. Le premier se glisse entre l’image de draps froissés et celle, nocturne, d’une pleine lune en majesté, au centre d’une couronne de feuillage. Les âmes sensibles établiront d’elles-mêmes le rapport entre ces deux images ainsi qu’avec le rêve dont il est question. La deuxième pochette présente, toujours en pleine page, une formation nuageuse singulière, qui s’élève verticalement dans l’azur, tandis que le bas de l’image est tout d’horizontalité, en deux couches : le haut de frondaisons déjà envahies par la pénombre, et l’étalement d’autres nuages. À son revers, les lignes noires, brouillées et entrecroisées d’un incertain reflet ; ce pourrait être une aquarelle. Au moment de le manipuler son poids nous alerte sur la nature du disque qui va surgir. Éclot alors la fleur, épanouie, virginale d’un picture disc. Un picture disc sur lequel il est toutefois déconseillé de poser son diamant puisque, dépourvu de sillon, ce disque est de carton. On peut néanmoins le faire tourner sur sa platine. Il n’existe pas de vitesse conseillée, mais plus elle est élevée – 78t si votre platine le permet –, plus l’effet produit à fixer cette image s’apparente à celui que recherchait Brion Gysin avec sa dream machine. Si l’on a l’audace de retourner cette galette, sa nature cartonnée, laissée brute, s’avoue pleinement. Mais alors l’étiquette centrale livrera, sous la signature de l’auteur, un avertissement qui ne manquera pas de nous plonger dans une profonde méditation : « regarde-le bien ». À ce point parvenu, nous ne gâcherons pas le plaisir de découvrir ce dont il est question et qui ouvre à plus de méditations encore. Et sur l’avenir[2].

Revenons en arrière. Entre ces deux pochettes est glissée une feuille imprimée, recto verso elle aussi, toujours avec le plus grand soin. Une main, de chaque côté, s’ouvre sans vraiment se tendre, dessinée, rose d’un côté, bleue de l’autre, et, retournons cette feuille, en position tête-bêche.
Au terme tout provisoire de ce parcours semé d’indices, le rêve a déjà commencé, comme l’offrande d’un cadeau se concentre dans le papier, la ficelle. Son emballage d’un bleu incomparable faisait autrefois d’une orange un trésor. La musique ? Il faut retourner au premier disque, en vinyle, avec un sillon, pour s’y rendre. Si l’on en croit l’étiquette du rond central, sa durée n’excédera pas 23’58’’ : sans avoir eu recours à un anneau de Möbius, Jean-Marc Foussat a su produire un objet à une seule face. Sonore. La seconde, en effet, se révélera aussi lisse qu’une noire patinoire.

Alors s’ouvre un autre espace, assurément rotatif. Le diamant enfin posé, le sillon déroule à des vitesses superposées un palimpseste de boucles qui satureront rapidement, dès que tracées, trouées et perspectives. L’horizon recule – c’est sa nature – sans l’offre d’un débouché. Un plan synthétiquement composé d’un bâton de pluie électronique, soutenu bientôt de signaux modulants au pinceau large et animé d’une pulsation sourde, sur lequel retentissent, tout près, puis dans le volume résonnant d’un hangar industriel, les coups de marteau d’un chantier où fermement l’on cloue. Surviennent les cloches fantasmées de bols tibétains, des traces de voix spectrales, presque inaudibles, et, enfin, un piano. Autant d’espaces qui joueront de leurs rapports d’ignorance mutuelle ou de complémentarité, de leur confrontation, superposition, en transparence ou en tuilage. Par la distribution des plans, leur présence alternée, le retour de motifs, leur métamorphose, cet ensemble dont la densité s’est constamment accrue prend un tour proprement symphonique. Ces espaces se déploient organiquement, sans se concurrencer : de la salle des machines à l’atelier, du chantier de plein air à la navigation en pleine mer, au magasin en bas de la rue ; du corps câblé de l’instrument, de ses circuits imprimés à toute sorte de cordiers, des marteaux du charpentier à ceux du piano, une chaîne métonymique se déroule inexorablement jusqu’à la sirène anamorphosée d’un navire lointain et son cortège de mouettes, d’embruns et de déferlantes. Une chaîne ininterrompue qu’il est loisible à chacun de laisser filer. Mais cette chaîne se croise, se recroise, ses frottements produisent des court-circuits. Ainsi, la mobylette qui surgit du grand large tel un poisson volant ramène au décor urbain d’une rue de faubourg et à la paisible échoppe du boulanger – mettons –, à ses conversations de quartier et à la sonnette du tiroir-caisse… laquelle pourrait être, à la faveur d’un de ces aiguillages oniriques, celle du retour-chariot d’une antique Underwood[3]. Alors, dans un espace tout à coup assourdi, feutré, dégagé, ouvert à un silence qui n’autorise plus que des événements discrets – l’aboiement lointain d’un chien, un secret ramage printanier, les notes égrenées par un piano songeur, un klaxon, des sons flûtés, de l’eau qui court…. – , ces précieuses minutes où le silence advient comme le sommeil retrouvé à la frange du jour accueillent les menus bruits de surface du vinyle, la surface matérielle du disque absorbée à son tour dans la musique, le contenant absorbé par son contenu[4]. Par-là se trouve anticipé le vieillissement du support, incorporé dans la forme le temps extra-musical, et, sans le réveiller, le réel au « vent perdu du rêve » (Éluard).
Avec Rêve, se matérialise, au sens fort, ce qu’ordinairement l’aube dissout, et que l’on pourra de ce fait continuellement rejouer.
Philippe Alen
[1]Comme pour Nouvelles (Fou FR LP 06-07 &DVD 01).
[2]Disons seulement que la chaîne métonymique dont il sera question plus loin ne cessera plus de s’allonger en proliférant pour peu que l’on suive à la lettre le conseil qui nous est donné.
[3]On pourrait aussi penser, puisque nous tenons là, un véritable « cinéma pour l’oreille », à l’extraordinaire raccourci d’un film de Hugo Santiago, Écoute voir (justement !), où deux lieux tenus distants tout au long débouchent in fine l’un dans l’autre.
[4]Un tour qui n’est pas sollicité par le commentaire ni n’a rien de fortuit puisque la réédition en vinyle de Nouvelles faisait déjà état d’un pareil sortilège.