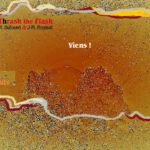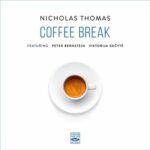Jazz à Luz #32 – Luz-Saint-Sauveur, 13-16 juillet 2023
32, c’est le nombre des sonates de Beethoven ; c’est aussi, cette année, celui des éditions de Jazz à Luz. À leur écoute, on peut juger d’une évolution qui est aussi bien d’un style – ici de programmation – que du temps qu’il épouse, reflète, et parfois sublime.
« – Foin du madrigal ! Il jure en ces champs sauvages… »
Léon Cladel, N’a-Qu’un-Œil

La petite église Saint-André de Luz-Saint-Sauveur, construite au XIIe siècle s’est vue, deux cents ans plus tard doter d’une enceinte fortifiée par les Hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem : d’épaisses murailles construites aux fins de résister aux attaques de mercenaires venus d’Espagne. La veille de l’ouverture du « 32e festival d’altitude », on pouvait y entendre Marc Mayraud, titulaire du grand orgue de Lourdes – ce qui n’est pas rien ! – tirer les jeux d’un orgue baroque allemand construit il y a douze ans. Cela ne figurait pas au programme du festival, mais le simple essai de sonorités différentes – pour animer le Lascia ch’io pianga de Haendel, par exemple –, anticipait agréablement cette nouvelle édition de Jazz à Luz qui peut, lapidairement, se résumer en une formule de « communiquant » : les états du son dans un lieu de résistance. La chaleur au-dehors se faisait écrasante ; ce moment de fraîcheur était le bienvenu.
Ouverture
En prélude au concert d’inauguration officiel, le duo de saxophonistes de Mamie Jotax (Carmen Lefrançois et Camille Maussion), acrobates pour l’occasion, s’ingéniait tout d’abord à prendre possession d’une sculpture en forme de manège qui mettait en chasse l’un de l’autre les effigies de métal d’un vautour fauve et d’un gypaète barbu. Elles s’ingénièrent à l’escalader pour, au trapèze ou en vigie, théâtraliser quelques notes de flûte ou de ténor, semées parcimonieusement au vent tout en jouant au ralenti à chat perché. L’exercice était périlleux en tous sens et laissait amusé, certes, mais dubitatif. À la manière du joueur de flûte de Hamelin, elles nous entraînèrent ensuite un peu plus bas dans la « Promenade du Bastan », le long du gave. Leur retour sur la terre ferme donna lieu à un autre registre de positions et de postures mieux adapté au développement d’un discours musical sans pour autant renoncer à leur petit théâtre de mines enjouées ou boudeuses, piquées d’interjections, de psalmodies ; à de charmantes embrassades enguirlandées de notes coulées, de slaps et autres fantaisies. Les attitudes déterminaient lignes et sons, leur assurance ou leur précarité, tour à tour les menaçaient, les enchantaient. Un titre résuma tout cela : Le moment quand ou le mot manquant qui opposa un instant cris et sérénade. Mais sous la couronne de sommets boisés coupés d’affleurements rocheux dont on devinait la masse derrière un plafond abaissé de brume, ce petit manège semblait un peu perdu.

Toujours un peu plus bas, Betty Hovette (p) serait en duo avec Nicolas Lafourest (elg) pour, donc, ouvrir ce festival dans une salle bondée du village de vacances Cévéo, au point qu’une bonne partie du public restée dehors ne put assister que de loin au premier volet d’une carte blanche offerte à la pianiste toulousaine à qui l’on souhaite de se détacher promptement de cet épithète restrictif. Avec une mélodie « pop » comme évidée, énoncée de façon clairsemée, Xibipíío – puisque c’est le nom amazonien que s’est choisi ce duo – gardait longtemps dans sa manche ses atouts maîtres. Annoncés pourtant par un grondement sourd venu du fond du piano, ils prirent forme d’un piétinement martial au cours d’un long crescendo. Trop de « gentillesse » recelait, on s’en doutait, la menace d’un avenir incertain. Un solo, et ce fut un déferlement de rafales qu’une discrète préparation de l’instrument rendit plus sèche encore. Ainsi transfiguré le timbre déjà métallique du piano aiguisa les angles que pourrait émousser un jeu tout en clusters. Celui-ci comporte l’inconvénient de jouer la masse contre la ligne et de perdre en énergie tranchante ce que l’on gagne en puissance de masse. Ici, rien de cela ; les mains plaquent, les poignets roulent, les coudes enfoncent, les avant-bras s’abattent, mais dans cette houle, le cap reste clair et le jeu du guitariste progresse de conserve : balayages, fouettements, griffures, la mélodie dévale sans plus d’encombres sa chaîne de montagnes russes. Les barreurs conduisirent le set à bon port en alliant la précision à l’efficacité.
Pour qui viendrait à l’improviste ou passerait par obligation, ce concert d’ouverture serait le prélude aux remerciements. Pour d’autres, ces formalités seront le moment de prendre l’air. Nous remarquerons à cette occasion que Jazz à Luz bénéficie d’une vraie cote de popularité et que ses tutelles l’ont assez bien compris. Éviter la disparition sans grossir à son désavantage demande intelligence et diplomatie, et de part comme d’autre. Madiran et Pacherenc salueront l’exploit.
Grand air
Le plein air, et surtout ce cadre montagnard, qui n’est ni celui, intime, d’un verger, ni celui d’une aimable campagne, imposent une énergie qui leur fasse pièce, quelle qu’en soit la nature, intense ou explosive. Une Balade, sous-titrée « pochette surprise », conduisait le lendemain ou le surlendemain, c’était au choix, au château, puis à l’aire de jeux d’Esquièze. Jalonnée d’étapes gourmandes concoctées par Bouillon Brume (Camille et Anna), c’étaient de vrais régals pour l’œil et le palais : bouchée de champignon, lovée dans une pomme de terre en chemise de pâte à sel, meringue sur schiste évoquant les névés disparus du Cirque de Gavarnie, cerises juteuses enneigées de sucre. Les discussions vont bon train, mais c’est pour faire une pause au pied du donjon où Aymeric Avice (tp, fghn) rachète son concert de la veille au soir, noyé, inaudible qu’il était dans une gangue de guitares déchaînées. Là, c’est la simplicité qui répond à l’austère empilement de pierres médiévales. Un riff coltranien des plus connus, joué sans fièvre mais à deux embouchures, puis une, puis rien sinon quelques variations fondues dans un moule d’époque : le seul phrasé jazz qu’il nous sera donné d’entendre en ces quatre jours. Or ce n’est ni un clin d’œil de connivence, ni un second degré sarcastique ; pas davantage de la nostalgie : quelque chose de naturel, cueilli à même le temps, sans notes de bas de page, sans même d’arrière-pensée, du moins peut-on le croire. Mais qu’il soit possible de le penser est déjà une forme de conquête, celle d’un cratère d’obus où se musser le temps que passe la mitraille. C’est peu, c’est beaucoup.
Plus bas, à l’ombre de quelques chênes et d’autant de frênes, on s’installe comme on peut dans le creux, sur les pentes herbues pour écouter Delphine Joussein (fl) que rejoint in fine Mélanie Fossier (vcl). Elles seront suivies par Brunoï Zarn et sa « guitare-bidon ».

Pour la première, comme une pièce jetée en l’air, l’énergie alternait ses deux faces. Guère de flûtiste à ma connaissance pour délivrer une telle charge brute et la modeler ensuite, avec force effets, boucles, delays, jusqu’à l’obtention d’une pâte sonore travaillée à la truelle et au couteau. Là-dessus fusent des échappées de voix, de souffle, tout un arsenal enfin, foisonnant de techniques, qu’interrompent abruptement des pauses élégiaques propres à réveiller en ces pâturages d’estive le passé virgilien de l’instrument. C’était bien avant les inventions de M. Boehm. Un phrasé profus, éclairé de gazouillis, de polyphonies acrobatiques et fragmentées préférées aux boucles paresseuses ; une accumulation de bribes promises à l’alimentation de turbines rugissantes ; un débit, puissance et densité, débouchent sur une clairière de printemps, nidifiée, à six heures le matin. Des chants indiens se profilent quand une soudaine attaque en piqué ressuscite un fameux Star spangled banner, ce qui, en ce calamiteux 14 juillet sonne à nos oreilles avec une ironie cinglante. De nouvelles bastilles sont à prendre, mais elles n’ont plus d’adresse et nous y sommes détenus. En descendant de l’estrade pour rejoindre Mélanie Fossier, déserté le bataillon de boîtiers, Delphine Joussein relève la pièce retombée sur sa troisième face, brièvement, le temps d’un échange à voix nues.

Un peu de vent dans les micros, un peu de voix gutturale, un amical tapotement sur le bidon de Labo inox (« pour moteur à grand rendement ») monté façon guitare – un peu customisé tout de même –, et Pipipi s’ébranle. Le blues parlé, le rock pesant et d’incertaines racines, pourvu qu’elles plongent en terrain lourd, dessinent les contours d’un territoire où faire pousser des variétés hybrides de chansons épineuses. Longue silhouette athlétique, crâne rasé, le regard noir, les genoux fléchis, Brunoï Zarn est équipé pour défier la montagne. Mais dans la torpeur d’une fin de matinée déjà torride, humour et décontraction font mieux que force ni que rage, et c’est tout en douceur que l’amadouera ce duo cahotant (Laurent Paris aux percussions). Avec humour, un « cha-cha-cha » émergera d’un chuchotis pour se muer peu à peu en une éructation autoritaire dans un yaourt multilingue au goût tomanien et qui se résoudra, quand la troupe s’apprêtera à entonner le refrain chaloupé à l’unisson, par un désopilant «shit-schnaps !» Un proto-mambo plus loin, suivi d’une évocation de Screamin’ Jay Hawkins versant scatologique, et c’est un coup de boule au micro qui s’inscrira dans l’anthologie des moments de Luz à l’égal de celui de Zidane dans l’histoire du football. Il était temps de déjeuner.
Le plein air, c’est aussi la lumière naturelle – et donc, le noir. C’est ainsi qu’une escouade se mit en marche dans la nuit avancée vers un lieu mystérieux, tenu secret, pour une ultime rencontre avec Betty Hovette en duo cette fois avec Laurent Paris : CiRuS ViRCuLe. Dans un faible éclairage, on pouvait distinguer dans l’herbe, dressé sur une couverture, un cadre de piano et quelques ustensiles posés à son côté. Les percussions étaient réduites à leur plus simple appareil. Formant cercle tout autour, sous les frondaisons que la brise seule révélait, on préparait ses oreilles. À l’extinction des feux il n’était plus question que d’écouter, avec, pour seul amplificateur, nos propres pavillons. Le seuil abaissé de l’audition dans cette nuit silencieuse, ni Betty Hovette, ni surtout Laurent Paris ne forcèrent le trait, la percussion se laissant oublier, arrondissant seulement les sons de cette grille, frottée, frictionnée, caressée, griffée, pincée, doucement flagellée, ces sons grêles qui se perdaient dans un espace désormais indistinct, sans plus de bords, sans extériorité, sinon sous l’espèce d’une intériorité extravasée. L’heure même (1h30) contribuait à rendre ce moment insituable. Au terme d’une journée emplie de musiques, après le déchaînement urbain de La jungle (nous y reviendrons), c’était une heure suspendue, presque soustraite aux comptabilités du jour. Il ne s’agissait plus de surprendre à tout prix, pas même de solliciter l’imagination à l’affût d’une patère où accrocher d’intimes fantasmagories. Le rêve n’était pas une injonction. Aux formations éphémères qu’à tâtons cherchait la ci-devant pianiste pas de contrepartie, tous gestes abolis ; à leur disparition surtout, dans cet abîme de la nuit, il n’y avait rien à opposer. La terre respirait, et nous à l’unisson. Il en allait d’une attitude morale.
Fallait-il vraiment que se refermassent ces grilles sur la nuit, que brutalement – c’est ce qu’il sembla – la lumière se fît, doublement électrique. Une lumière crue jetée sur les épaules de deux guitares branchées sur le secteur : Dramatic Bongjo ; un son dur pour Nicolas Lafourest (elg), un autre plus grincheux sous les doigts ou le couteau à peindre de Marie Olaya (elg). Un protocole presque dogmatique opposait à des mélodies simples, au caractère volontiers de rengaines, certaine volonté de les agresser en les déjouant, de les détruire par tous moyens, distorsion, bruitisme, discordances accusées. À volume soutenu, démultiplié par le silence de la nuit, après ce moment passé dans une connivence totale avec le lieu et l’heure, cette musique avait perdu tout sens, sinon celui d’une abstraction en phase avec ce qui, timidement, commence à rendre le monde « intolérable »[1].
In furore
À quel point le volume peut détruire la musique, quand bien même elle tendrait décidément au bruit et à l’abolition de l’antinomie qui l’oppose aux « sons organisés », le concert de Pomme de terre en serait l’illustration. Deux guitares électriques, Richard Comte et Niels Mestre et une batterie, Étienne Ziemniak[2] (dms) entouraient Aymeric Avice (tp). C’est avec ironie, provocation et un peu de brutalité tout de même, que ces quatre-là ont retourné l’adjectif infamant par lequel on a liquidé le jazz : « Jazzy » étant aussi le nom d’une variété de tubercule en principe particulièrement goûteux, « de bonne tenue », et qui cuit rapidement. Pomme de terre fait encore mieux : elle cuit instantanément. Dès l’entrée de la Maison de la Vallée, transformée en « club » aux heures tardives (c’est ainsi qu’une BD informant les festivalier de l’esprit de Luz la désigne…), la distribution de bouchons d’oreilles donnait le ton. Ce n’était qu’un barrage contre le Pacifique. Dans un espace confiné, bondé, aux murs de pierre impassibles, l’écoute n’est certes plus au programme : il s’agit de « transe ». « Il y a des gens qui dansent sans entrer en transe et il y en a d’autres qui entrent en transe sans danser », notait Prévert. Ici, on a dansé, un peu, mais en matière de transe on restait loin du compte. Du côté de la scène, Avice semblait davantage préoccupé de s’entendre – et peut-être même de se faire entendre – au travers de la chape de plomb qui l’écrasait. Pour le reste, signalons qu’il existe à Luz une masseuse (absente de l’espace publicitaire du programme) qui peut certainement procurer plus efficacement les sensations de massage intérieur que l’on oppose généralement aux nostalgiques du free-jazz le plus débridé, dépassés sur leur gauche par cette Noise aux intentions paradoxales. À ce titre, on peut s’interroger sur un dispositif qui substitue une deuxième guitare à la basse, se privant par là d’une puissante source de vibrations intestinales, et Comte paraît infiniment plus remuant lorsqu’il se limite à une note tenue ou un long accord pulsatile[3].
Avec La Jungle des Belges Mathieu Flasse (elg, kbds, vcl) et Rémy Venant (dms), qui intervenaient sous le chapiteau, le parti est franchement pris d’une soirée à danser, avec pop star, décibels, fumigènes et tout le saint-frusquin, jeux de jambe et de lumière. Maximum d’effets pour un minimum de musique. La danse des canards version XXIe siècle et sociologie institutionnelle : la mixité des publics se retrouvera dans le bilan comptable. Dans la salle elle n’était pas flagrante. Là, néanmoins, l’objectif était atteint.
Ce n’était pas le cas de Fiasco – Clémence Pantaignan (vcl, elg), Eric Avondo (elg), Damien Maurice (synth), Matthiew Tyas (kbds), Jérôme Renault (dms). Le mieux est encore de citer le programme : « tension folle », « transe électrique » (encore), « surréalisme »… « Comme des Romains, nous n’aspirons qu’à rejoindre l’arène ». Pourtant, plutôt que de tendre le pouce vers le bas ou de se laisser bouffer par les lions en communiant avec « la grande prêtresse », il était temps d’emboîter le pas à la majorité silencieuse, et Bølen fit les frais. Pas d’Bøl et sa promesse d’une musique « massive, brûlante, vibrante, faite de débauche d’énergie… pour danser tard dans la nuit. » Pour en finir, citons toujours, mais cette fois un texte de la chanteuse : « Il faut rire aujourd’hui et jusqu’au bout ! » Rions. Quand le nietzschéisme est retourné en argument publicitaire, en compagnie du jazz et du surréalisme, que nous reste-t-il en effet ? Fiasco.
Le lendemain, Moby Duck accomplissait au mieux ce programme , fixé par d’autres. Desservi par une sonorisation confuse, on devinait pourtant que les effets de confusion n’étaient pas tous voulus. Essentiellement écrites par Xavier Camarasa (fender rhodes), d’improbables chansons au cours improbable, cabossées, avalées, recrachées comme une patate chaude trouvaient en Mélanie Fossier (vcl) une voix propre à théâtraliser leur impayable ironie – et provocante, le « duck » en question passant par tous les sorts que lui réservent une gastronomie inventive, en ce pays Toy point trop éloigné du royaume du foie gras. Delphine Joussein (fl), montée sur ressorts, Rafaëlle Rinaudo (harpe), harpiste patiente, Frederick Galliay (elb), bassiste impassible – un bloc de granit où pousse une barbe – Ianik Tallet (dms), complétaient ce vaisseau intergalactique qu’on ne peut guère comparer dans l’inspiration qu’aux assemblages douteux de Frank Zappa. Rien de stable, tout peut chavirer à tout instant, quitter son orbite, visiter des planètes comme on fait le tour du quartier en semant quelques boulons, en perdant de l’huile sans perdre le nord. Un démarrage sur un solo de flûte ne laisse pas d’inquiéter, car plutôt qu’une mélodie enchanteresse, c’est le souffle du dragon qui s’échappe du tube, transformé peu à peu en épaisse mélasse, d’où se détache la voix sur un fond de harpe saturé. L’alliage de la voix et de la flûte augmentée est parfois osé mais très réussi dans une composition qui se délite, écartelée, démembrée, désossée, reconstituée façon poupée de Bellmer. Chanson, rock psychédélique, free-jazz se télescopent ; tacles, contre-pieds, ruades sèment sans doute une majorité silencieuse, mais cette fois le pas n’est pas emboîté : on ne saurait d’ailleurs pas sur quel pied partir lorsque, nous cueillant à chaud, un solo de harpe à découvert surgit de ces fumées baroques en faisant assaut de chromatismes qui remontent le temps et convoquent l’histoire de l’instrument, de Wagner à Dvořák pour ne pas remonter jusqu’au roi David… Moby Duck, une volaille bien troussée.




Toujours dans l’énergie, et à la Maison de la Vallée mais cette fois dans l’après-midi, dépouillée de son rôle de « club », SaMouche, emmené par Marc Démereau (bars, scie musicale), rassemblait autour de lui Marie Olaya (elg), German Caro Larsen (elg) et Thomas Fiancette (dm). Une fondamentale installée, d’abord mise en boucle, puis percutée par de brèves saccades de guitare, lacérée par les éructations du baryton, fondue dans la masse secouée de trémulations électroniques. L’attente ainsi créée fit place nette au déboulé de la batterie qui emballa soudain le tout. Un tout comme un volcan actif, qui crachait en tous sens ses filets de lave vite solidifiés en une pelote hirsute mais tenue ferme par le bon bout. Un tapotement répétitif sur le bois de la solid body fit figure d’imitation d’une boucle qui se superposait à celle qui, déjà, infiniment se dupliquait par en dessous ; que Marie Olaya casse une corde, sa réparation orchestrée fut immédiatement recyclée en un tumulte assumé, loin de la débandade. Aussi, quand un solo de baryton résolument « free » emporta l’ensemble à sa suite, quitte à abandonner derrière lui ses prothèses électroniques, la musique s’en trouva-t-elle aussitôt rafraîchie. Un espace s’ouvrit où Démereau s’engagea pour élaguer plus avant, scie à la main – scie musicale s’entend. Rien d’éthéré toutefois dans un solo qui parfois évoqua un zélé laveur de vitres. Jamais à court, c’est à l’alto qu’il terminera ce concert tumultueux soutenu par la scansion des guitares. Par des gestes répétés, elles feront écho à sa plainte, comme s’il fallait bien, à regret, en finir.

Entracte
À deux lacets de Lourdes, le vrai bain de jouvence était, à Luz, le spectacle concocté pour les enfants par la Compagnie La Muse. Charlène Moura (comp.) y avait laissé d’impérissables souvenirs dont on parlait encore. Avec Sophie Boudieux (comp., fl, acc, objets), elles avaient mis au point avec finesse, intelligence, goût et poésie, une mise en scène délicate sur un thème bien abstrait : l’ouverture au monde. Avec Dedans-Dehors, il leur a suffi d’une tente, de quelques caisses et de beaucoup d’imagination pour émouvoir et fasciner un nombreux public d’adultes qui perdirent instantanément les années superflues accumulées au-delà de l’âge de raison. Un mobile, des ombres chinoises, des saladiers prenant visage, un herbier de mots choisis avec une précision de chimiste maniant des matières dangereuses et le savoir précis de leurs effets, quelques chansons douces, un accordéon, un baryton, des voix de conteuses attentionnées, un sens juste du temps et du tempo et, par-dessus tout, une présence d’illusionniste : le monde puisse ressembler un jour à celui auquel elles désirent éveiller les jeunes enfants…
Deux jours plus tôt, nous avions entendu un orchestre de jeunes du Conservatoire de Tarbes en clôture de la projection des films de Mathieu Amalric sur John Zorn. Avec entrain et justesse, ils avaient donné trois pièces de Masada (Peliyot, Hadasha et Ravayah). C’était en interlude, entre les Zorn I (2010-2016) et II (2016-2018), où l’on pouvait suivre ce roublard touche-à-tout de génie de répétitions en concerts, toujours satisfait de lui, et Zorn III (2018-2022), la passionnante mise en route et répétition de Jumalattaret,une pièce vocale qui met au défi de la chanter la virtuose Barbara Hannigan. Rompue à la musique contemporaine, elle s’avoue pourtant mise en échec par les extrêmes difficultés accumulées dans cette partition par un Zorn qui se montre aussi attentionné qu’habile diplomate – manipulateur, serait-il trop dire ? La musique comme travail, le travail de la musique, la musique en travail, Amalric a donné à voir ces trois aspects confondus comme trois visages de l’amour ; et en particulier, de celui qu’il porte à ces artistes. Qu’on partage ou non sa fascination pour John Zorn importe peu à ce point parvenus. L’insertion des délicieux prologue et postlude de Zorn III, empruntés aux images sulpiciennes qu’on suppose tirées d’un film « symboliste » finlandais[4] – entre Disney et Gallen-Kallela –, rappellent qu’au-delà du documentaire, ces films sont d’un auteur. Son absence excusée n’entrava pas l’efficacité de ces films puisque, depuis la salle, certains raflèrent les dernières places disponibles pour l’audition en novembre de Jumalattaret à la Philharmonie de Paris (où l’on pourra retrouver Moby Duck et Pomme de Terre).
Puisqu’il s’est agi, ici, de figures variées de la jeunesse[5], des petits aux vieux enfants, pas question de faire impasse sur les adolescents attardés. Le Pablo Gïv Free Trio, venu de Cologne, était « à découvrir de toute urgence ». Avec eux, c’était l’Eurovision. Pablo Gïv (tp, electr.) mâchonnait l’embouchure de sa trompette sur fond d’un ostinato mollement grattouillé par Farida Amadou (elb), tandis que Laura Totenhagen (vcl, electr.) chuchotait quelques borborygmes sans conséquence. Et cela longuement : la transe (encore) ? Avec un peu de constance dans l’effort, on pouvait assister à l’émergence de modes de jeux tels que les chocs de la coulisse d’accord ou des pistons mis en boucle, de petits cris de souris chuintés ou susurrés nourrissant tout ensemble un ressac électronique en forme de berceuse. Il faut s’imaginer le trompettiste en jupe longue, une longue tresse tombant sur le côté, boucle d’oreille et barbe noire tenue court, une bassiste impassible en short de cuir et tresses de feu, et pour le contraste, une chanteuse en robe droite, toute simple, jaune poussin et maquillage de poupée Barbie. Les photos étaient interdites à la balance, en débraillé, mais pas en concert, ce qui changeait de l’ordinaire. On avait en somme des enfants éveillés au monde par La Muse, mais à celui qu’avant bien d’autres avait décrit René Dumont. Rien ne sortait de la trompette, rien de la basse, ni rien de la voix. Au total : trois fois rien. Un promoteur avisé leur conseillera peut-être d’engager Conchita Wurst pour l’Eurovision 2024.






La même Farida Amadou se présenta seule le lendemain, tout auréolée de sa présence au côté de Peter Brötzmann, qui devait disparaître quelques jours plus tard. Un drone tiré de sa basse posée à plat sur les genoux, des harmoniques se détachent, un accord répété, saturé : le jeu s’évase en montant en volume et en densité. Le balayage s’accélère, varie ; le médiator crépite. Un peu de jeu à la baguette, un peu de tapping pour prolonger l’effet de balafon qui se profile dans une mélodie de trois notes. Tout cela tuilé qui se conclut sur une partie assez martiale, et voilà. Pas tout à fait puisque, avec un grand sourire, Farida Amadou nous livrera la clé de son esthétique, enfin : « J’ai encore une minute trente de son. Encore. Ça va ? » .Va pour une minute trente de son, ça ne mange pas de pain…


Persistance du jazz : Betty Hovette
Après avoir ouvert le festival, avant de l’aventurer pour le perdre dans la nuit, deux fois en duo, Betty Hovette (p) était sous le chapiteau, en trio, cette fois, pour le deuxième temps de la carte blanche que lui avait offert Jazz à Luz dont c’était, d’une certaine façon, le concert de jazz. De ceux qui assurent, aujourd’hui, sa persistance. Sébastien Bacquias (b) etFabien Duscombs (dm) étaient ses complices pour rendre un vibrant hommage à Don Pullen. Seuls les partisans d’un historicisme strict pourraient trouver à y redire. On leur opposera la poursuite d’un élan premier dont l’énergie ne s’est pas perdue en route… Belle idée tout d’abord de faire entendre la voix de ce pianiste en lever de rideau, une voix à la fois proche et spectrale. Venue des haut-parleurs, sa corporéité s’y tenait toute : la joie, l’énergie, un timbre rieur, son débit de gravier : une présence, convoquée comme lors d’une séance de tables tournantes. Le trio n’eut plus qu’à déferler, explosif. Sur les mots du warrior tournant sur eux-mêmes, Betty Hovette déplia la panoplie de ses gestes hérités : l’entier du corps engagé, roulant des épaules aux poignets, dévalements, remontées, affirmation des poings, colliers de notes, jusqu’à ce que, l’allure s’espaçant, elle visitât l’intérieur du piano. Le jeu sur le cordier donna alors le pas à une lente walking bass, puis à une simple pédale sur laquelle des accords égrenés chargeaient leur allure rêveuse de l’énergie qui les avaient amenés. Le feu couvant sous la braise reprit de plus belle pour s’épuiser et mourir enfin sur une longue résonance. En quatre pièces et un rappel, le trio démontra que vivait au présent le legs de ce pianiste attachant dont reste unique la manière de lier ensemble blues, gospel, calypso et free jazz. Les accords plaqués, d’amples gestes semés de notes claires assemblées aux virages en phrases laconiques pouvaient ainsi dévoiler soudain leur socle de blues et prendre à la faveur des mots de Dannie Richmond et de Charlie Mingus… « spirits »… une dimension hymnique. Un solo de contrebasse, piquetée du talon de l’archet conduisait aussi bien à un passage plus élégiaque. Une dernière pièce débutée sur un rythme de valse vira de bord pour aborder un calypso endiablé. C’est un vrai trio, ferme et fluide, sonnant haut et fort, qui ce soir du 13 juillet, forçait les portes du temps. Avant de se dissoudre dans un rappel débuté en forme de gospel, Betty Hovette tint à rappeler, avec une émotion palpable, l’amour que lui avait inspiré Don Pullen, qui il avait été : un musicien de l’entre-deux. Peut-être une autre façon de dire qu’il avait su être un musicien de l’Un.

Les voix humaines
À Luz, il y a un usage des lieux redoublé par une symbolique. Le chapiteau accueille en première partie le « grand concert du soir », ensuite, on range les chaises : on pourra danser, avant le « clubbing » à la Maison de la Vallée.
Le premier jour, le trio constitué par Vera Baumann (vcl), Florestan Berset (elg) et Gerry Hemingway (dm),soit MingBauSet, électrisait le chapiteau. Depuis qu’il a pris son envol hors des formations qui ont bâti sa réputation, le batteur américain n’a cessé de séduire en des attelages inusités, toujours de grande classe. Déjà cinq ans d’existence pour ce trio hélvète, issu de la Musik Horschule de Lucerne où Hemingway enseigne aux côtés d’Urs Leimgruber et de Lauren Newton : une pépinière de talents. Cinq années qui n’ont pas dilapidé la fraîcheur des premiers échanges, l’évidence qui a porté ses membres à former un ensemble. Il nous semblait assister à son éclosion. Au premier coup de mailloche nous retrouvions la frappe profonde et sensuelle de Gerry Hemingway. Celle qui, il y a vingt ans exactement, et non loin d’ici, avait eu pour nous le sens d’une intime confession. Tendrement mêlée au chant de Vera Baumann, une litanie syllabée, murmurée mais précisément timbrée, elle la soutint, l’enveloppa, la caressa. Ce qui s’exprimait ici effleurait instantanément le cil vibratile qui relie l’oreille au cœur. Et le trio fut ainsi tenu, intense et plein d’assurance au bord du vide. Car la guitare de Florestan Berset longeait l’abîme dont elle dessinait les contours ; il joua en creux les instants décisifs, jardina les bordures. C’étaient trois portes pour pénétrer le mystère d’un abandon sans réserve au temps : une définition possible de l’improvisation. Nul alanguissement cependant. La nervosité contenue de la battue, la clarté d’intention dans les inflexions de la voix, la décision même de la guitare quand elle paraît évoluer comme une ombre à l’arrière-plan, tout cela et la façon d’intégrer, sur une cymbale, par le bout des baguettes, le moindre triolet chanté, d’en illuminer le sillage par une furtive phosphorescence des cordes, tout cela imprimait une direction qui ne laissait à l’écoute aucune marge d’incertitude quand aucune voie n’était pourtant tracée.
Dans ce trio sans basse, elle était partout. Dans la scansion d’une batterie qui ne faisait qu’un avec son timbre ; dans le groove le plus souvent sous-entendu que trancha, fracassant comme un éclair, un coup répété de caisse claire ; invisible, se faufilant sous le masque de la guitare. La voix pouvait ainsi se fragmenter légèrement sous l’effet d’un petit dispositif électronique, utilisé avec économie. Lorsque Gerry Hemingway emballa soudain le train, la batterie sonna comme un chœur dans lequel on entendrait toutes les voix, chacune reflétant l’unité du tout. C’est ce chœur qui résonna lorsque fut venu le temps d’une puissante, intense, implacable mais souple polyrythmie. Toms, cymbale, charley, caisse-claire, grosse caisse, tous les éléments enfin d’une batterie que l’on a plaisir à énumérer comme les noms de ceux qui composent cette masse le plus souvent anonyme d’un chœur, et qui s’apaisa dans un finale magnifique où, rejoignant sur le fil la voix de Vera Baumann, Gerry Hemingway y percha la tourterelle qu’il tira en magicien d’une sourdine animée de son souffle.
Même endroit, le dernier jour. Anne Montaron était invitée à présenter une autre voix, celle d’Isabelle Duthoit (vcl, cl), dans un trio de format comparable en compagnie d’Andy Moor (g) et Steve Heather (dm, électr.). Un autre monde. Presque son envers s’il en était un ; mais, contrasté, tendu entre les deux extrêmes du cri et du chuchotement, il en serait plutôt le négatif. La voix, Isabelle Duthoit la pèle jusqu’à l’os, car elle y a mis au jour un noyau de résistance, une pointe sur laquelle se déchire ce qui en elle fait chair, met en lambeaux ce flot charrié du souffle, des haillons qui vibrent à leur tour, multipliés, vivants et qui battent. Ce qui semblait un cri, un cri unique, tenu haut, longtemps, se ramifiait, se stratifiait en un schiste organique, pendant de celui, minéral, qui tout autour fait cercle. Andy Moor travailla une épaisse matière, grasse et charnue. Avec Steve Heather, toujours pertinent, ils attisèrent une énergie rock au travers de laquelle, térébrante, passait la voix comme une lame. En esquissant un arc dynamique au tracé sans bavures, de la main et des bras, Isabelle Duthoit sculptait un corps de danseuse à ce cri qui paraissait sans fin, s’alimentant à ses propres cendres, soutenu par une dramaturgie puissante. On eût dit d’une araignée tissant une cotte de maille, du travail d’orfèvre dans une ambiance de forge. Et de cela naquit une sorte de cantilène, reprise tout bas, susurrée, qui progressivement se fit haletante, gravissant inexorablement une pente qui menait au bord d’un précipice – où le silence brutalement nous cueillit.

Cette performance, nécessitant un engagement total de part et d’autre de la scène, connut une contrepartie à la clarinette avec un départ sur un nuage de souffle, peu à peu diffracté, irisé d’aiguës, doucement changé en envol de ramiers.





Le retour réclamé de la voix suivit ce rappel des oiseaux, et c’est dans le voisinage de Sainkho Namtchylak qu’Isabelle Duthoit approcha ses propres Nightbird(s)[6], proches mais farouches – tentants. C’est leur force et leur beauté ; douce et sauvage, celles du chant tel qu’ici libéré.
Épilogue




S’il y eut encore deux concerts, ils ne bénéficièrent pas après cela d’une écoute suffisamment impliquée pour que ces lignes en retiennent mieux qu’une vague rumeur perçue au travers des ultimes conversations tenues au coin du bar. Comme La Compagnie du Coin, dont les animations de rue, certes « décalées », n’auront pu accrocher qu’une oreille distraite, que CxK nous pardonne,ainsi que Ramdam Fatal dont l’énergie rock n’excluait pas des accents de fanfare imaginative. Simplement, nous avions suivi les oiseaux…


Un peu auparavant, Aman Tékés avait su nous séduire avec son rébétiko sincère, parachuté sur l’estrade érigée pour eux devant la gare de Luz, à tout prendre l’endroit idoine pour une musique toujours en partance. Ce sextet emmené par Emanuela « Manupe » Perrupato (vcl) et Alain Fourtine (bouzoukis) aura réchauffé l’atmosphère qui s’était fait un instant capricieuse en donnant un contrepoint méditerranéen au blues dont l’esprit avait déserté bien des tréteaux.
Enfin, il ne chantait pas, mais sous sa tignasse et derrière sa moustache, il était de tous les concerts : Jean-Pierre Layrac qui présentait là son 32e « festival d’altitude », a fait de ce festival une sorte d’état des lieux. Si l’on compare le programme de ses 32 éditions depuis 1991[7], on se fera une idée assez parlante d’un festival qui ne se sera pas dissout dans la sono mondiale comme la plupart des « grands » festivals – et des moins grands – mais qui aura néanmoins pris quelques options significatives ; les discuter n’a pas sa place ici. En revanche sa présence assidue dit beaucoup, et en premier lieu qu’elle les assume. Et avec lui, une équipe fidèle. Merci, et à demain…
Philippe Alen, textes
Jean Yves Molinari, photos
Yann Causse, interviews

[1]Pour reprendre le titre d’un des derniers livres de René Dumont, Un monde intolérable (1988)… que pourtant nous tolérons depuis son verdict sans appel. Plus tard, au cours d’une table ronde animée sur la question de la « Transition écologique dans les lieux et festivals de jazz », il fut largement question de cette double programmation contrastée. En résumé : la question de la décarbonation apparut comme un leurre, réduisant abusivement le problème plus général de la pollution – notamment nucléaire – et, à ce titre, celle de la « pollution sonore » : se profilait derrière celle-ci, la problématique du respect. On avait pu la toucher de manière sensible lors de ce concert. À la décharge de la programmation, ici mise en cause, il faut notre que l’ordre de ces concerts avait fait débat, qu’il n’avais pas été tranche, ce dont le programme imprimé témoigne qui présentait les concerts de cette nuit dans l’ordre inverse.
[2]Dont le nom polonais se traduit par « pomme de terre ».
[3]Vordonis (Sunkun music, Nunc 020), ou Dérive de la base et du sommet (Nunc 022).
[4]Qui, sauf erreur, n’est pas mentionné au générique.
[5]Baudelaire en distingue quatre dans sa préface à : Léon Cladel, Les martyrs ridicules, disponible sur Gallica : Les martyrs ridicules / par Léon Cladel ; avec une préf. de Charles Baudelaire | Gallica (bnf.fr)
[6]Sainkho Namtchylak, Lost Rivers (FMP, CD42, 1991).