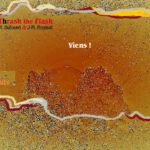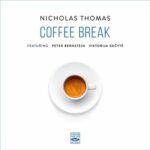Généreusement accueilli dans la vaste cour du château La Vallade, le festival Jazz&Bass a réussi son pari. Mieux que d’avoir tenu des promesses dont il s’était sagement abstenu, il a conquis un public qui a immédiatement répondu présent par un judicieux dosage de ce qui est généralement attendu, en pareille période, d’une manifestation de ce type et de propositions qui le sont moins.

La cour d’un manoir Renaissance, vastes frondaisons en fond de scène, granges ouvertes pour la restauration, haies et pelouses (golf alentour), salle attenante pour masterclasses et conférences, La Vallade offrait en somme le cadre idéal et la jauge raisonnable pour accueillir confortablement les quatre cents et quelques locaux et estivants tardifs qui ont répondu à l’appel de la cloche : le nom d’Henri Texier étant de ceux qui battent le rappel et ravivent des mémoires sexagénaires. Un programme débutant après la sieste ou la virée touristique1, mais enfilant en compensation trois concerts complémentaires ouvrait assez largement le compas esthétique.
Pour commencer, du jazz rigolo et manouchisant avec Paris-Paname2. Répertoire comme son nom l’indique : de Mozart à la mode swing avec Marche turque déhanchée, à Boris Vian, Gainsbourg ou Nougaro, avec en prime un blues récréatif et grasseyé. Puisque la contrebasse est mise en avant, un solo de Patrick Manet tenta de convoquer les baleines mais, dans ce monde impitoyable de l’amplification obligée, cela sonnait plutôt rasoir électrique. Avec À bicyclette, le jazz s’en allait par les chemins qui lui maintiennent un reste de popularité : le second degré, celui du simulacre. Du champ de coton aux champs dans lesquels on se roule, avec ou sans Paulette, un siècle est passé, le jazz est devenu cette lingua franca qui autorise au mieux d’heureux métissages, au pire un globish musical sinistrement ludique. Paris-Paname tire son épingle de ce jeu de dupes en alignant chant gouailleur, guitares allègres, basse bondissante et clarinette charmeuse dans tous ses registres : tout le monde s’y retrouve et c’est le but : « On est pas là pour se faire assommer» !
Contraste maximum avec le Butterflies trio de Fred Borey3. Avec un set débuté par une longue ballade, nous nous retrouvions projetés dans un présent du jazz qui, devenu une musique certes savante, ne fait pas les pieds au mur pour autant. La formule du trio exige autre chose. Alors qu’une partie de l’assistance s’égaillait au bar d’où l’on pouvait entendre, tout en discutant, les échos lointains de ce qui se passait sur scène en prenant éventuellement prétexte de quelques gouttes, prenait forme en somme une version rurale et de plein air du tant célébré jazz club, pas davantage. Si l’on prêtait pourtant une oreille attentive, se profilait alors l’autre versant du club, creuset de la beauté éphémère où elle se donnait à qui voulait l’entendre. Ce sont à ces heures enchantées que l’on pouvait penser, entre chien et loup. Aux antipodes du latin de cuisine, c’était une langue précise, qui prenait le temps de peser chaque note, d’élaborer une syntaxe propre à dire ce qui ne peut se livrer autrement qu’en musique. Une syntaxe de longue portée, à la ponctuation délicate, usant sans préciosité des virgules, des points virgule et des tirets, à la balance classique quoiqu’au fait des raffinements harmoniques de la modernité, travaillée du souci de la précision comme du doute et du questionnement, trouvait pour s’exprimer le tempo juste, ni alangui ni laconique, disons réfléchi, pensif. Et c’était merveille d’entendre cette pensée prendre forme, s’envoler par paliers, aborder des giratoires de buse en chasse, revenir sur soi pour s’élever. Une belle composition, Dear Joseph,dédiée à un vaillant voisin dont le portrait dressé en quelques mots par Fred Borey laissait penser qu’ils avaient beaucoup à partager, en silence, illustrait tout cela. Mais le choix d’interpréter le Four in one de Monk, l’une de ses compositions acrobatique bien peu fréquentée, en disait long aussi sur l’attention portée sur la matière à travailler. Un réel engagement, de courtes formules néanmoins dépourvues des coups de boutoir rollinsiens, mettait en valeur ce sens de la conduite passant par des sonorités engorgées, souvent empreintes de douceur et de réserve. Une longue complicité donnait en outre à la contrebasse de Damien Varaillon des allures d’évidence, mais la sorte de constance dans le renouvellement du miracle venait de la batterie constamment inventive de Lukmil Perez Herrera. Dénuée de tout effet facile, elle engageait avec un souci pointilleux du détail une partie tenue à égale distance du commentaire et de l’échappée. Jamais seulement efficace, toujours chantante, elle étincelait sans aveugler. Frotté de mélancolie, ce set s’accordait parfaitement aux incertitudes du temps et à la nuit tombante.
Un tivoli dressé sur la scène pour protéger de la pluie fit également obstacle aux projecteurs et Henri Texier en fond de scène dut se contenter de la pénombre, laissant ses comparses se partager le halo bleu qui les enveloppait4. Ce qui du reste convenait assez bien à sa stature de menhir du jazz français. Avec Laguna veneta donné en ouverture, la partie est assurée. Mieux qu’un succès, c’est, depuis Indian’s week, un hymne, un signe de reconnaissance. Il y en aura d’autres. Cette efficacité mélodique des compositions de Texier Henri jointe au jeu mesuré de Texier Sébastien jusque dans ses dérapages très contrôlés fait mouche. Avec un son droit, sans afféteries, ni acide ni pleureur, l’alto de ce dernier trace une voie directe qui ne perdra personne, celle d’un certain classicisme en phase avec l’honnêteté foncière de la musique de Texier. Lequel connaît néanmoins tous les ressorts de la séduction : outre celle de ses mélodies chantantes (Sand Woman, Black Indians) qu’il a transmise en héritage (Cinécittà, de Sébastien Texier, Laniakea de Gautier Garrigue), un standard (What is this thing called love) suivi d’un Round’Midnight dédié à Tavernier (proposé sous la forme d’une devinette) et Besame mucho pour conclure, introduit par une manière d’alap à la contrebasse solo, c’était un sans faute. Un jeu de chat et de souris autour de minuit entre Henri-Tom et Gautier-Jerry – silences soudains, redémarrages impromptus, walking bass rapide – prenait à partie un public pris plaisamment au piège de ces échanges malicieux et prompt à se prendre les pieds dans le tapis ; quant à la fameuse mélodie de Consuelito Velázquez, elle scellait avec un brin de roublardise le pacte d’amour sur lequel reposait le dernier set de la soirée.
La deuxième journée de Jazz&Bass s’annonçait au beau fixe. Un grand soleil estival a donc accueilli Philippe Monge pour la dernière performance d’un stand-up dont il a déjà été question dans ces pages lors de sa première charentaise à Pougemin5. Texte inchangé, mais contexte différent. Or le déplacement est au cœur des pratiques de Philippe Monge, praticien des zones de turbulence, et pas seulement dans le domaine de la contrebasse – ce passage de la Ligne des positions aventureuses qui fit sourire, entre tous, les adeptes de l’instrument. S’il n’a pas l’enveloppe de Raymond Devos, il joue parfaitement d’une frêle silhouette qui contraste aussi bien avec les rondeurs de « grand-mère » que celle de son devancier avec sa scie musicale. Les bras écartés, les paumes ouvertes vers le ciel soulignent les évidences, trois doigts ramassés en bouquet forment une insistance : autant d’impasses, autant d’illusions dont le constat désabusé forme la trame de ce spectacle qui renvoie à l’irrémédiable solitude d’une condition que tous partagent et que rend assez bien la présence sur scène d’un petit homme face à une grosse contrebasse. Alternant sketches et chansons, la parole introduit la musique, et, en anglais (on imagine ce que l’on croit comprendre), d’une voix claire aux harmoniques se mariant parfaitement à celles de l’instrument, prennent forme des situations ou chacun se reconnaît, dont le pathétique le dispute au burlesque. Du même coup, quelques questions et difficultés fondamentales troublant tous les musiciens sont abordées concrètement : comment chanter une chanson d’amour, comment chanter et jouer en même temps, etc. De fil (à couper le beurre) en aiguille (dans une botte de foin), on sera conduit à une impayable dissolution de tous ces problèmes existentiels dans une reprise déshabillée, et donc ravageuse, du Viens danser de Bécaud, version Montagné. D’un Gilbert l’autre, toujours la question de l’Autre…
Parrain du festival, animateur, en prélude à son ouverture d’une masterclass partagée avec Marie-Christine Dacqui (laquelle donna lieu au concert d’un orchestre de contrebasses), Diego Imbert se présentait en quartet6, un pianoless quartet eût-on précisé quand ce n’était pas si fréquent. Et, de fait, il prit immédiatement sa forme historique : fondée sur deux parties librement contrechantées, A l’aube embarqua sur tempo rapide les deux solistes dans une fougueuse équipée. Plutôt qu’un contrechant cependant, ce furent deux solos fournis, pas tant ferraillant que déroulés simultanément. L’effet pouvait être saisissant, mais – balance difficile, amplification déséquilibrée ? Changer de place n’y faisait rien – la confusion l’emporta. Tout sembla ainsi précipité, brouillon et pour tout dire chaotique. Avec Les vagues, les courants contraires, appelés par instants à se recouvrir justifiaient mieux le parti compositionnel. Quand vint Combray, l’arrière-plan proustien mis au jour, les mots venaient au secours, mais à la condition, comme pour illustrer le propos de Philippe Monge, que l’imagination supplée la compréhension : il est généralement douteux, dans tous les projets de ce type, que coïncident les lectures et leur part de fantasme ; sans parler de leur mise en écho, de préférence à l’idée de les simplement transposer d’un idiome à l’autre. La large place laissée à la contrebasse, mise en avant par la balance, la substitution du bugle à la trompette,le tempo s’assagissant, le phrasé pouvait évoquer certaine allure proustienne, laquelle trouvait enfin, dans La recherche à se confirmer. Un motif de basse répété ostinato installait un climat calme et solennel sur lequel David El-Malek s’avança, calme et réfléchi, épousant superbement les lentes volutes qu’on déployait sous lui comme un tapis. Imbert avait expliqué auparavant sa mise à profit du confinement pour s’engouffrer dans la Recherche. La musique telle qu’on pouvait l’entendre dans cette cour bordée de verdure conservait en quelque sorte, et à coup sûr à son corps défendant, la trace de cette lecture confinée. Les silences ménagés pour une atmosphère distendue, comme dans Le temps suspendu, sonnaient un rien artificiels et ne fonctionnaient guère dans cet espace ouvert, tandis qu’on imaginait la magie qu’ils pouvaient dispenser au studio comme au disque, au salon. Ainsi, le solo de trompette sur très peu de notes a-t-il pu sembler, ici, dans ces conditions, un peu laborieux (Couleurs). En revanche, sur une allure globalement medium, on pouvait admirer le sens du découpage de David El-Malek (Spirales) se jouant des changements de tempo, lent ou rapide selon les sections (même procédé dans Paperoles où se devinaient les constants retours de l’écriture dans une demande toujours accrue de précisions).
Abstraction faite de ce Proust encombrant, restait que l’on sortait de ce concert avec le sentiment d’avoir dû constamment rapporter ce que l’on entendait à un autre lieu et un autre espace, apportant ainsi un sérieux amendement au fameux propos de Sartre (« Le jazz, c’est comme les bananes, ça se consomme sur place »). Mais quelle place ?
Une question qui ne se posait plus à propos du concert suivant, le dernier7. Celui qu’on n’attendait peut-être pas ici. Contrebassiste et chanteuse, Sélène Saint-Aimé a résolu d’emblée les dilemmes posés précédemment par Philippe Monge : de sa voix puissante et contenue, avec un timbre comme nimbé, avec une intonation désarmante, à la fois douce et affirmative, son chant est indissociablement berceuse et invocation. Sa basse, ferme et profonde, à mi-chemin du commentaire et du dialogue, chante avec elle, nourrice et confidente, âme-sœur. Par ses origines mêlées, française, ivoirienne, martiniquaise, elle est la créolité incarnée. Et c’est un répertoire largement caraïbe qu’elle arpente, résultat d’une recherche et d’un engagement. Même l’anglais qu’elle aborde dans Moves8 sonne créole. Ce qui se révèle plein de sens puisque les paroles de cette chanson font du chant un chant d’amour, et que cet amour s’entend ici, bien au-delà des personnes, comme celui d’une langue et d’une terre : les Caraïbes. Le tambour ka de Sonny Troupé qui prend la place centrale d’une batterie réorganisée autour de lui fait se lever ainsi, outre un paysage et des couleurs, toute une histoire qui porte la musique au-delà d’elle-même. Dans Maho qui la met en valeur, les fûts parlent, et le chant atteint une dimension hymnique. La voix, qui opère d’emblée à un niveau qui exclut tout cliché, tout mensonge, troublante par la sollicitation d’une oreille accordée à ce qui la porte (Whispering a song / To the one who cares / Sweet and gentle moments / Feelings to be shared, sont les premiers mots de Moves, et pourraient figurer en exergue de tout ce concert), la voix agit alors comme une voix intérieure. Tant intérieure qu’Adrien Sanchez semble en ses obligatos, en ses solos, l’entonner à son tour. Le ténor, admirable dans ce même refus de l’effet, installé sans se renier dans ce même registre de douceur, de confiance éperdue en ces mélodies simples et renversantes se glisse dans son ombre, épouse ses couleurs à s’y confondre et, dans la nuit tombée, fait oublier la fraîcheur qui s’est invitée : l’envoûtement est total. Quand le voyage en créolité se poursuit à la Nouvelle-Orléans (Quan’ Mo té Dan Gran’ Chimain), la question du lieu, de la place, ne se pose plus : c’est là. Sélène Saint-Aimé chante, et son trio avec elle, là où chantait Bessie Smith, par exemple, dans un lieu qui n’est plus nulle part : celui de la résonance sympathique. Quel que soit l’instrument, et ce trio le prouve, ténor, percussion, contrebasse, cette voix soulève toutes les autres. Un lieu, un place qui est aussi le présent. Philippe Monge (quand tu nous tiens !), faisait une heure auparavant le lien entre les deux sens du mot : oui, Sélène Saint-Aimé nous faisait présent du présent9.
Ce présent-là n’appartient pas au temps, à celui qui passe : ce serait même, justement, ce qui ne passe pas, qui est toujours disponible (une façon de continuer la lecture de Proust). Celui de la réminiscence donc, et là, aux premières notes de Sélène Saint-Aimé, et jusqu’aux dernières et désormais au-delà, c’est une autre caraïbe, haïtienne, immense qui s’est profilée, a pris place à ses côtés : celle de Toto Bissainthe. L’immense Toto Bissainthe, celle qui, inconnue de tous, aux côtés de Colette Magny et de Catherine Ribeiro a chaviré les milliers de cœurs présents au Sigma 74 de Bordeaux. Il reste une trace de ce concert, grâce à Charlie-Hebdo et à Delfeil de Ton. Trouvez-le lisez-le10. C’était un autre monde. Un monde qui quelque part subsistait ce soir-là, dans un village de Charente-Maritime.
Philippe Alen, texte
Loïc Bettendorf, photos (avec nos plus sincères remerciements)
1Nous sommes tout près des lieux d’une découverte majeure : celle de « Pierrette », Néandertal tardif, qui bouleversa le monde de la paléoanthropologie (« Un néandertalien dans du Châtelperronien ! » s’écria Bernard Vandermeersch).
2Paris-Paname : Gilles Cunin (g, vcl), Jean-Paul Bouët (g), Patrick Manet (b), Inge Andersson (cl).
3Butterflies trio : Fredéric Borey (ts), Damien Varaillon (b), Lukmil Perez Herrera (dm).
4Sébastien Texier (as, cl), Henri Texier (b), Gautier Garrigue (dm).
6David El-Malek (ts), Quentin Ghomari (tp, fghn), Diego Imbert (b), Frank Agulhon (dm).
7Adrien Sanchez (ts), Sélène Saint-Aimé (b, vcl), Sonny Troupé (dm, tambour ka).
8Composition et texte de Doug Hammond. Moves figure dans le disquede Charlie Mingus où Doug Hammond est chanteur invité, Mingus Moves (1974), avant même que Doug Hammond l’enregistre pour son propre compte(Reflections In The Sea Of Nurnen (1975), puis repris dans A Real Deal (2007).
9C’est là toute la différence avec le « revivalisme » qui présente le passé comme passé. Et, à ce sujet, revient cette remarque d’un ami camerounais, Théo, guitariste de jazz, qui dans le mitan des années ‘70, quand l’usage des échelle pentatoniques faisaient encore figure de modernité s’exclamait: « Les pentatonique, les pentatoniques… mais ma grand-mère me chantait des berceuse en pentatoniques… ! »
10Delfeil de Ton, Palomar et Zigomar tirent dans le tas/2, p. 366 (10/18, 1975). Sous le titre « Chants de femmes », Delfeil de Ton rend compte de la fièvre suscitée par ce concert.