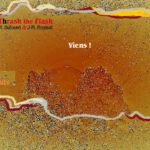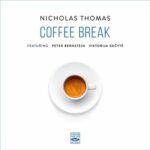Rencontres musicales d’Archipels – Châteauneuf-sur-Charente – 24-25 juin 2022
Quittée l’aisselle de Saint-Pierre aux liens, ces quatrièmes Rencontres seront passées des territoires de l’église à ceux de l’État. Il y avait là de quoi ouvrir un abîme de songeries. Pour la musique, par la musique.

La Salle des Fêtes
Craintes de tout piano – sauf ceux de Ross Boletter[1] –, la pluie, la grêle, la chaleur excessive menacent tout concert en extérieur et les loueurs de Steinway ne sont pas friands d’une aventure en extérieur, or, cette année, Archipels avait une envie de piano. Châteauneuf s’était réjoui de l’hébergement de ces deux journées de musique tombées du ciel, il lui fallut donc proposer un endroit clos et couvert. Les revers du ciel charentais avaient en peu de temps fait défiler ces trois intempéries, s’en protéger n’était plus optionnel, la Salle des Fêtes s’offrait en solution. Rhabillage en Salle municipale d’une ancienne halle commerçante, elle résume une époque, on saurait s’en souvenir.

Violaine, violence – Violon ?
La lecture juste par Violaine Schwartz, son auteur, d’un texte percutant, violent dans sa nudité[2] – relation de vies massacrées d’avoir fui le massacre, administrativement bafouées jusqu’à leur pure négation, des vies d’hommes ballottés d’identité perdue en fausse identité assignée, de femmes sans ombre sommées de prouver jusqu’à leur existence – cette lecture, comment en faire une lecture musicalement accompagnée ? d’un violon de surcroît ? Un violon ! Des voix s’élèvent aussitôt pour dire ce malaise, d’Adorno après Auschwitz, ou de Godard à Cannes (« …je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plan !… »), des voix qui nous prennent en otage, nous-mêmes, aujourd’hui, otages de ceux qui en notre nom viennent de reconduire à leur poste les tenants de cette administration aveugle qui ne vaut, en temps de paix, guère mieux que celle qui jadis organisait, en temps de guerre, le départ des trains ; plus moderne, elle fait maintenant décoller des avions charters. Alors, violons ?

Envisageons autrement la question ; et si l’on est musicien, violoniste de surcroît, que faire sinon en musique. Plutôt que de la musique, ouvrir la musique au désarroi qui saisit et ces existences sans nom, sans-papiers, et les nôtres, de républicains aux bras qui en tombent, laissés sans voix sur nos sièges, dans ce lieu dont la façade s’orne du « RF » d’un autre temps.
C’est donc, d’abord, affaire de rythme. Articuler les coups d’archet à la parole, à ses silences, à sa stupeur. Avant d’aborder des récits de vie, chacun plus atterrant que l’autre, le glossaire administratif donne le ton : sa litanie de sigles – d’ADA à ZAPI– et leur développé qui déploie le filet aux mailles fines dans lequel seront prises ces âmes errantes, nos sans-papiers ; un tamisage par les mots de l’absurdité du réel, qui la redouble d’une opération symbolique que seule, à son tour la langue peut dénoncer : travail d’écrivain. Coups d’archet brefs, sans destination claire, divaguant dans cette jungle alphabétique, accusant les angles de ce labyrinthe abstrait d’intervalles disjoints : travail de musicien. Ce seront ensuite des lignes segmentées, d’un chanté-parlé dont Pifarély a le secret, qui circuleront tout près de la parole, sans la gêner mais sans s’effacer, tressant avec elle le fin contre-point qui ombrera son oppressante charge émotive d’un très discret figuralisme. Glissades, sauts, pauses, envols. Passeront en interlude des oiseaux migrateurs, et même, noms parmi les noms, d’autres qui ne le sont pas. (Soupçon que ce contrepoint aérien où reprendre haleine ne mette en scène que de nouveaux sans-papiers, également surveillés, mis en liste avant complète disparition.) Un dernier interlude tourne le regard vers le contrechamp ordinaire de la banalité du bien, traitée sur linoleum usé, sous l’œil de la machine à café, par la bureaucratie ordinaire.
Affaire de rythme, qui règle le débit; affaire de tact pour conduire cette ligne et la contenir dans d’étroites limites, entre le sens absenté et le lyrisme inopportun. Il y fallait de la précision, l’écriture y a pourvu, l’attention, l’écoute, la respiration. C’est tout un pour Violaine Schwartz, comédienne avant que d’être écrivain, pour Dominique Pifarély, le musicien que l’on sait, et pour tous deux ensemble formant attelage depuis des lustres. Il n’est pas hors de propos de rappeler les débuts de leur collaboration : un travail sur un fameux « apatride » habitant du seul langage, déjà, administrativement contraint à la domiciliation et à la nationalité (française): Ghérasim Luca. « Libérez le souffle et chaque mot devient un signal » : son apophtegme est le timon de cet attelage. Alors, violon !…
Rayon de lune
Prendre la relève après la commotion ressentie n’était pas tâche aisée. Dans une salle obscurcie, le piano curieusement appareillé d’un dispositif électronique éleva très doucement la voix sur deux accords qui semblaient ouvrir les Tableaux d’une exposition. Pourtant, on le comprendrait sans tarder, on assisterait plutôt au déploiement progressif de rouleaux horizontaux chinois plutôt qu’au parcours d’une exposition, sautant de cadre en cadre. Méticuleusement posés, avec une lenteur qui accorde toute sa place aux résonances, une note ajoutée, une harmonique retirée, ces accords se modifient dans leur répétition, laissant affleurer l’esquisse d’une mélodie que rien ne vient brusquer. Encore est-ce trop dire, ou pas assez. Des ambiguïtés travaillent ces accords de l’intérieur, les minent ; ils bourgeonnent. Les voies tracées se ramifient dans une temporalité qui néanmoins manque les dissoudre à mesure de leur apparition. C’est une avancée à tâtons dans la nuit, avec la retenue de la prudence, sans l’inquiétude de la menace. La beauté du son, la sûreté du toucher tiennent la main. Tandis que l’on s’accoutume à l’obscurité, un trait soudain la zèbre comme un éclair – « c’est du jazz !»-, et ce sera sans suite : un éclair de chaleur.

Deux pièces progressent ainsi à pas comptés. La pénombre dans laquelle est plongé ce coin de salle, où trône une lampe aux formes généreuses, le seul point vraiment lumineux, dans le dos du pianiste, aide à la concentration ; c’est cependant dans un noir mental, archaïque, que s’affine l’écoute. Tout à coup, une note isolée au sein d’une troisième s’enveloppe d’un halo impalpable, qui la gonfle comme un lainage sous un manteau, lui prête un volume d’emprunt, l’ombre d’imprécision. Ce détail prend dans l’ensemble étal auquel on s’est accoutumés des proportions de montgolfière. Cette incursion de la prothèse électronique donne tout son sens à son usage minimal, organique, d’éclosion discrète au sein même du piano. On peut seulement regretter que sa préparation demande au musicien de se lever pour manipuler un peu longuement les potentiomètres en trahissant des intentions dont la musique ménageait la surprise. Du coup, on percevra peut-être comme un maniérisme cette ultime note issue du haut-parleur après l’arrêt subit d’une phrase dérivante au clavier, menacée d’emballement. C’est là peu de choses. Ces interventions de l’électronique se borneront à cela, dans une conception quasi-lichtenberguienne du click and buzz : guère de clicks, à peine de buzz. Avec des accords resserrés – autrement dit, étendus –, toujours tenus en lisière de la consonance, avec un art de la litote et de l’évitement, lorsque le pianiste développe brièvement, c’est à Paul Bley que l’on peut penser ; la distillation d’accords suspendus, elle, transpose une manière – superficielle sans doute – d’entendre Morton Feldman. Deux noms ici pour indiquer des directions en passant, rien de plus. C’est déjà beaucoup.
Antonin Rayon testait alors, semble-t-il, un répertoire nouveau enraciné tout de même dans une tendance profonde, contemplative, portée par un abandon au temps que l’on aura pu déceler par le passé sous des déguisements divers[3].
Le sourire de SuperKlang
« Bonsoir », ainsi se présentent Frédéric Aurier et Sylvain Lemêtre, avec un humour élégant, efficace aussi puisque, tant qu’à faire, c’est le nom de la pièce par laquelle ils ouvrent le ban. Ban qui s’ouvrait autrefois au son du tambour[4]. C’est d’un attirail autrement sophistiqué que dispose le percussionniste. Qu’on en juge : une table résonnante sur laquelle disposer au gré des pièces cymbales ou bols, où coincer des baguettes à mettre en vibration, une tige filetée que désescaladera marche à marche une rondelle, en prenant son temps – un temps à subdiviser de toutes les manières possibles –, clochettes et gongs suspendus tout autour, étagères de bols chantants et, sous elle, au pied gauche une cloche de bois, au pied droit une grosse caisse. Et j’en passe. Par exemple cet énorme bol au son très grave qui, derrière Lemêtre, ne servira qu’une fois – la bonne. Côté cordes, en alternance avec le violon, le nyckelharpa, connu de qui fréquente les musiques traditionnelles de Suède et de Norvège, a droit à une introduction qui fait de l’organologie une branche de l’érotisme : « Prenez un alto et une vielle à roue, enfermez-les dans une chambre ; quand vous ouvrez, vous avez un nyckelharpa. » Ou une, cet instrument n’a pas de sexe, ou bien il en a deux. Tant de précautions descriptives n’ont d’autre but que de provoquer l’imagination à se figurer toutes les combinaisons acoustiques possibles, étant entendu qu’un répertoire d’une belle originalité embarque des traditions qui vont, du nord au sud, de la Suède à l’Inde, et, si l’on veut, d’est en ouest de l’Asie à l’Afrique, sans plus de précision. Car d’être trop précis conduirait paradoxalement à rater la cible. Sur les ailes d’une ébouriffante polyrythmie, plus affolante encore d’être conduite avec une aisance frisant la désinvolture, des mélodies malignes prennent un envol qui les porte ailleurs, loin de leur origine supposée, vers un horizon de fantaisie constamment renouvelé. Aucun abus des boucles chères aux fonds traditionnels, non plus que de recours immodéré aux divisions compliquées du temps. Si l’on trouve tout cela, et bien des choses qui requerraient l’emploi d’un lourd arsenal ici hors de propos, c’est transcendé par une inépuisable invention mélodique, un goût très sûr, une maîtrise technique hors-pair, bien sûr, et l’aboutissement d’une complicité de quinze années. Tout cela réuni autorise les échafaudages les plus complexes, des unissons périlleux sur des lignes que ne désavoueraient ni les violonistes virtuoses de la tradition carnatique ni les grands maîtres des tablas ou du zarb. Les mains occupées, les pieds et la tête aussi, à n’en pas douter, reste la bouche : comme un dernier étage vient s’ajouter à une invraisemblable pyramide d’équilibristes, deux pièces demandent encore à la voix de se joindre au concert et, non content d’ajouter un niveau à la polyrythmie en cours – qui est, notons-le, également une polyphonie de timbres –, elle répartit encore ses effets d’onomatopées, de souffles et de sifflets sur ces deux organismes musiciens, jouant à son tour des possibilités qui s’offrent d’alternance et d’échos. « Organismes musiciens », c’est à dessein qu’est venue se glisser cette locution maladroite aux fins de couper court à l’impression d’un agencement un rien trop automatique que pourrait faire naître ces quelques lignes. Car l’ultime beauté de cette prestation pourrait résider en cela qu’à aucun moment elle ne trahit la mise en route d’un engrenage qui déroulerait, bien huilé, sa fatalité mécanique. Légèreté, souplesse au contraire attestent le vivant. La fameuse définition du rire par Bergson (« du mécanique plaqué sur du vivant ») en était la confirmation négative : jamais SuperKlang n’a suscité le rire, malgré l’évidente dimension de théâtre musical que l’on pouvait déceler. Mais un sourire constant courait sur les visages, et celui des musiciens, expression de la joie.

Il fallait cela pour, non pas effacer – diable ! –, mais faire pièce au désarroi ressenti dès l’ouverture de ces Rencontres.
Mise au rond-point
Depuis un an, les Allumés du Jazz, a adopté une formule déconcentrée de ses fameux Ronds-Points des Allumés[5] qui permet d’aborder partout où c’est possible une multitude de points tournant carré dans le système désorbité de la musique en général et du jazz en particulier. Il fut donc question de « La musique encombrée. Les musiciens face aux bullshit jobs.» (à écouter d’urgence ci-dessous).
L’exposé de Pierre Tenne renseignera précisément sur l’état de la « culture administrée » (Marcuse) et des progrès de la bureaucratisation de la musique.
Ouvrant la deuxième journée de ces Rencontres, c’était là un pendant idéal à la lecture de Papiers : les musiciens se voyaient symboliquement traités comme les réfugiés sans-papiers, sommés de remplir des rames de formulaires, parasités par une multitude de tâches qui les éloignent toujours davantage de la pratique qui, seule, fait d’eux des musiciens. Joël Pothier, universitaire, décrivait à son tour le même phénomène à l’œuvre dans l’enseignement supérieur, et son intervention ressemblait à s’y méprendre à un voyage en absurdie. Au détour d’une phrase, Pierre Tenne mentionnait la convergence de tout cela vers la mise en place de moins en moins discrète d’une société de surveillance et de contrôle. À l’insu (ou presque) de ses participants, tous, du paysan, de l’artisan au musicien, puisqu’il était question de lui, œuvrant à l’expansion du domaine du mensonge, institutionnel et institutionnalisé.
À vous de jouer – Monniot/Ducret
Il était temps de troquer l’obscurité promise en avenir pour celle d’une salle que la musique seule se chargerait de rendre intime. Mieux encore par ce temps de grisaille et de pluie, chaleureuse. Davantage par la présence d’ailleurs, pour ce qui concerne le duo qui met en ligne plus qu’aux prises Christophe Monniot (ss, as, bars) et Marc Ducret (elg), que par ses compositions. Les titres de l’un et de l’autre furent joués en alternance, des pièces aux lignes généralement abstraites et distanciées, faisant contraster fluidité et jeu staccato. Chant-son (Ducret) traçait de la sorte les grandes lignes du programme. Avec le thème suivant (de Monniot), le guitariste donnerait libre cours à ses tropismes les plus rock en s’engouffrant dans une futaie de riffs dressés au saxophone au-dessus d’un taillis de syncopes. Au débouché sur une calme clairière, la messe était dite. Attaché à structurer puis déstructurer un matériau mouvant, ce duo reformulait en douce l’un des principes attendus de la formule qui veut qu’en duo l’un des pôles figure un relatif point fixe autorisant à l’autre une libre gambade. La haute stature, droite et ferme de Monniot, les reptations de Ducret semblant vouloir s’entrelacer à lui-même paraissaient accréditer cette vision quelque peu traditionnelle. Des approches plus pointillistes, à l’évocation d’un temple, le soprano puis l’alto descendant les registres ; plus abandonnées, pour la transposition d’une Histoire, écrite à l’origine pour dialoguer avec un violoncelle sur des pages de Calvino (Si par une nuit d’hiver un voyageur) ; un jeu de cache-cache avec la ritournelle du Dernier tango à Paris (signée Gato Barbieri) ; il y a sans cesse à accommoder l’oreille. Calvino serait d’ailleurs à ce jeu un bon guide, expert en construction labyrinthique, en réglages et déréglages de la machine fictionnelle ; son enrôlement, indiciel, invite de pièce en pièce à revisiter le parcours.

Concluant leur concert par une brève intervention, Ducret ne dit pas autre chose. En rendant hommage à l’initiative de ces Rencontres, à la mise en présence d’un vrai « public », composé de sujets, avec des musiciens pouvant être perçus là selon une échelle et des procédures appropriées, il eut ces mots : « C’est à vous de jouer… » Ce qui, à l’aune de ce que l’on venait d’écouter, s’entendait en tous sens.
Sortilèges, envoûtements – Pifarély/Couturier
À l’instant de mourir, Goethe demandait : « Plus de lumière ! ». Mais certains organismes vivants, justement, en demandent moins, qui se dessèchent en pleine lumière pour n’exprimer qu’à la nuit tombante leur pleine exubérance. Ainsi de certaines musiques, non qu’elles soient nécessairement de caractère crépusculaire, mais cette heure suspendue fait luire différemment leurs contours, qui prennent forme d’un filigrane doré à la rencontre de l’ombre et de la lumière, exaltant l’une et l’autre. De très anciennes gravures des maîtres du clair-obscur indiquent une disposition du regard mieux propre à apprécier leurs trésors chuchotés. Si l’œil écoute, l’oreille voit. Que voit-elle ? Rien qui fasse image, ou c’est obstacle. Il n’est pas question de visions oniriques, ou de psychédélisme, simplement d’un acte vide, d’ouverture à ce qui est.
Les deux premières notes, piano et violon, parurent émaner d’une sonate de Brahms – comme Moussorgsky la veille du piano d’Antonin Rayon –, mais la troisième déjà, en quête d’une province où s’établir, transportait en passant par la fin de siècle française, dans la Vienne au début du siècle suivant. La porosité de l’espace et du temps, de la mémoire aussi, rend possible un tel périple ; reste à le rendre réel, à quoi Dominique Pifarély (v) et François Couturier (p) se sont employés : Couturier, avec une infinie délicatesse, Pifarély la lui rendant ouvragée en de miraculeuses courbures, virevoltantes, diaprées, iridescentes. Opposé au danger de voir s’évanouir dans une insignifiance décorative telle richesse dispensée avec tant de prodigalité, une profonde gravité brossait les fonds. Elle donna notamment à la deuxième pièce l’allure de marche harassée de quelque wanderer venant à point nommé donner un corps à cette exploration mentale. Il répondrait par là même au soupçon de formalisme que de vétilleux esprits pourraient faire lever. Ce n’est qu’à la faveur de quelques traits de piano, coulés d’un toucher incisif dont la douceur proscrit la brusquerie, que le versant jazz se révèle, soudain, à la manière dont on fait de la main apparaître un dessin sur un velours en le caressant à rebours. Et c’est I loves you Porgy, dans un traitement très sophistiqué, ou bien encore La chanson des vieux amants, introduite par un piano d’outre-tombe, la voix blanche de cordes écrasées sul ponticello, en prélude à une envolée libératoire sur une pédale comme un glas : « Moi, je sais tous tes sortilèges / Tu sais tous mes envoûtements ». Cette adresse, pour peu qu’on l’ait saisie de la façon la plus consciente, pouvait exprimer, très au-delà de sa littéralité, l’entier du rapport à la musique qui sous-tendait ce qui se donnait ce soir-là. Entendue de manière plus subliminale, elle se vivait dans un partage qui justifiait, une fois encore, l’écho que donna Pifarély aux paroles de Ducret, un peu plus tôt, pour conclure ces Rencontres. Oui, nous avions joué. Ensemble. Et ce terme choisi de « Rencontres » vérifiait l’intention de donner à ces deux journées une autre ambition que d’être un « festival » de plus.
Afin, toutefois, que ce programme-là aussi soit rempli, la musique fut invitée à quitter ce coin de la salle où elle s’était réfugiée en recréant un espace intime dans la boîte sans âme de cette halle reconditionnée, pour s’installer sur la scène, la vraie, celle qui, le plus souvent, assure aux professionnels de dispenser leurs notes comme on jette du grain aux poules, lesquelles sont, pour le coup, à la fête. Question d’état d’esprit. Après la pause dont la nécessité n’était pas seulement d’ordre technique, Ciac Boum sut assez vite remettre les énergies dans le sens de la danse et ramener sur terre sans dommages. Il y fallait bien du talent, de l’entrain et une dose de culot pour que les traditions du Poitou se fassent une place dans ces journées. Christian Pacher (v, vcl), aux justes intonations, son fils Alban (v), qui ménagea d’étonnants chorus, et Julien Padovani (acc), de qui l’on connaît d’autres dimensions[6], s’employèrent donc avec succès à faire tourner des rondes sans serviettes, à s’écarter en se serrant la main, puis à se resserrer sans que ce soit ni « facile », ni « débile ». La nature retrouvée de cette Salle des Fêtes, plus en accord avec son programme d’origine, se trouvait au terme des ces deux journées enrichie de dimensions nouvelles au point qu’on pouvait un instant se représenter leur fusion[7]. « La société qui discourt sur les fêtes n’a plus que des fêtes appauvries dans la réjouissance privée, ou dégradées dans un néo-folklore chargé d’entretenir une fausse mémoire collective » diagnostique l’historienne Mona Ozouf[8]. Ces 4e Rencontres d’Archipels, par la musique, et rien que par elle, avaient tracé, le temps d’un éclair, pour une petite assemblée, une voie pour relever le défi d’une autre société où les discours, les mots « festif » et « ludique » s’effaceraient devant la fête et le jeu. Peut-être est-ce la raison de tant de beauté alliée à tant de gravité.

Philippe Alen, texte et photos
J.Paul Gambier, photos additionnelles et captation
[1]Entretien avec Ross Boletter sur dMute.com : http://urlmini.net/r/2CG94P7
[2]Violaine Schwartz, Papiers, P.O.L., 2019.
[3]Qu’on l’écoute, par exemple à l’orgue, en 2010, aux côtés d’Ellery Eskelin dans les superbes archives que celui-ci a mis à disposition sur Bandcamp : http://urlmini.net/r/VY4RZWG
[4]C’est aussi, bien sûr, la pièce qui ouvre le disque de SuperKlang qui vient de paraître, SuperKlang, Umlaut (UMFR CD36).
[5]Pour mémoire, ces tables rondes débutées à Avignon en 2018 par une session de deux jours résumée en une revue (disponible ici) et un disque, se sont depuis poursuivies aux six coins d’un hexagone qu’elles ne cessent d’élargir au dimensions d’un polygone très irrégulier : Voir le site des Allumés du Jazz : http://urlmini.net/r/4VPUXE2
[6]Cf. notre compte rendu de l’édition 2019 d’ Écouter pour l’Instant.
[7]Que les électeurs locaux d’une députée du Rassemblement national sachent entrevoir cette fantasmagorie, serions- nous tentés d’ajouter…
[8]Mona Ozouf, La fête révolutionnaire, 1789-1799, Gallimard.