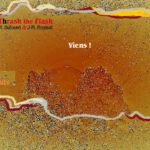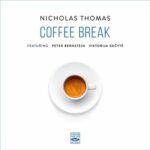Tony Malaby – Angelica Sanchez – Tom Rainey
Tony Malaby (ss, ts), Angelica Sanchez (wurlitzer elp, p), Tom Rainey (dms)
Poitiers, Confort moderne, 23 mars 2022
par Philippe Alen, Jean-Yves Molinari et Florence Ducommun
Un trio au point triple
Si l’art repose sur la mise en œuvre et l’exploitation d’un tenaillant paradoxe, le trio réuni ce soir de mars en était la plus vivante incarnation. Dans une lumière chichement comptée, les trois musiciens se sont lancés sans autre préambule dans un long et unique set intimidant, mené de bout en bout comme un tour du monde à la voile et sans escale, chacun faisant ce qu’il avait à faire, sans un regard l’un pour l’autre, et pour cause. Les vieilles complicités se passent de paroles et cela fait presque trente ans qu’elles se partagent – pour ce qui concerne Malaby et Sanchez, à la ville comme à la scène. Mais ce n’est pas tout. Le saxophoniste, que l’on pourrait prendre pour le jumeau d’Henri Texier, même carrure, ressemblance troublante, jusqu’au bonnet vissé sur le crâne, tangue d’un pied sur l’autre comme un métronome quand le batteur à sa droite allie, impassible, une allure de sauterelle à l’énergie d’un boxeur ; la pianiste, elle, s’est mise à l’abri sous la meule d’une épaisse chevelure noir de suie pour n’en plus émerger. Car c’est bien d’immersion qu’il s’agit, mais d’un type un peu particulier. Rien d’océanique en effet dans une musique qui pourtant se joue des limites et brouille les repères.
Dirigée fermement mais sans but évident, rhétorique sans contenu manifeste, lyrique sans profil mélodique distinct, cette musique touche au plus profond, comme la confidence d’un inconnu. Tentons de nous expliquer.
Les premières notes du ténor avancées une à une, comme timidement, isolées, engorgées, douces et rauques en sont les premiers mots, ceux qui rompent le silence en proposant un pacte. Si l’on se figure le chant du rossignol – celui des cours d’eau le soir, pas celui de la chanson – on se fera une idée du discours à peu près ininterrompu qui sera tenu tout du long. Sa continuité ne fait pas de doute, la logique implacable qui le soutient non plus, mais l’on serait bien en peine d’en résumer le cours. C’est une rumination, un soliloque dont les bribes n’ont que la consistance du sujet qui s’abandonne, drapé de sa nudité, qui suit des chemins escarpés, tortueux, et dont la voix, le timbre rugueux, fêlé, divisé, tendre sous l’écorce, dit à la fois la puissance et l’abandon. Mais c’est sur des roulements presque martiaux, n’étaient leur retenue, qu’il s’avance porté par un courant d’eau claire échappé du Würlitzer. Le gestuelle de Rainey est impressionnante, qui embrasse la totalité de son set d’un mouvement giratoire, les bras tenus parallèles, passant des cymbales aux toms et sollicitant la caisse claire à chaque passage. Son jeu se lit, s’entend et se figure tout ensemble. Passée au piano, au son rendu semblable à celui d’un clavier électronique par l’amplification, Angelica Sanchez s’évanouit dans ce tourbillon, confondue avec lui. Embarqués dans ce qui semble se poursuivre comme une rêverie sans fin, ni sans fin possible, le souffle nous est coupé sans préavis comme au milieu d’une phrase – d’une coupure de courant. C’était un courant, c’est une coupure.
La musique reprend, un nouveau babil, d’autres rugissements sourds, des sifflements flûtés, et toujours le fil d’une émouvante confession dans laquelle passerait le souvenir d’une vieille grille rouillée qui ne cesserait de s’ouvrir, le souffle d’un Ben Webster visualisé par Bacon, modelé par Giacometti. Une confession, c’est clair, qui n’associe pas des voix complémentaires, se répondant en interagissant, merveilleusement accordées, mais coule d’une voix unique qui se répand à travers les canaux différenciés de trois instruments. Une conception non plus génialement conversationnelle du trio, mais son abolition : nous assistons, sans en revenir, à un monologue à trois. On a pu dire que la musique du quartet de Coltrane se laissait mal déduire des manières de chacun de ses membres pris isolément. Ce miracle se reproduit, à ceci près que le mouvement de transcendance du quartet légendaire s’inverse en plongée dans l’intimité d’une psyché inquiète, celle d’un organisme unique, unicellulaire. Que nul vague sentiment d’expansion infinie ne menace de dissolution une écoute empathique, mais qu’au contraire celle-ci se voit impliquée par un phrasé minutieux, une horlogerie follement inventive, huilée avec génie car Angelica Sanchez est à la fois partout et nulle part. Il serait impossible d’extraire sa partie, laquelle n’aurait guère plus de sens qu’une flaque de sang répandue hors du corps auquel elle donnait vie, mais essentielle à ce trio sans contrebasse qui pourtant semble nourri à un inépuisable placenta. Pas plus qu’il n’est de thème vraiment identifiable, fondu qu’il est dans un développement qui ne développe rien mais creuse inlassablement de fragmentaires implications, il n’est de place pour un solo, l’objet fétiche du jazz, sa marque, son acmé – ou bien, conséquence du « monologue à trois », c’est un « solo d’ensemble », comme depuis Bartók, ont pris nom des « concertos pour orchestre ».
La fascination produite par ce trio tient sans doute à la forme concrète donnée à une sorte de perpétuel bégaiement, un malaxage, dans lequel tente de se dire avec un inouï souci de précision ce qui sans cesse échappe, se refuse, se reprend, insiste, marmonne et ce faisant se donne forme. Une forme donnée à la coexistence à l’équilibre de puissances affirmatives, négatrices et interrogatives : la musique maintenue au « point triple », celui où coexistent les trois états de la matière, solide, liquide et gazeux. Un point atteint sans marcher sur des œufs, en lisière du silence, mais au contraire dans une profusion dense, ébouriffante. Et généreuse. Au terme de trois longues pièces, Malaby en suggéra une quatrième sur le bout des lèvres, puis, alors que ses comparses s’apprêtaient à se lever, il reprit le collier de son ténor, les engageant dans un dernier tunnel, manifestant une furieuse envie de jouer. Sa part du pacte établi avec un public essoré par une écoute tendue, sidérée, qui avait pleinement assumé la sienne.
Philippe Alen, texte
Jean-Yves Molinari, photos à Poitiers & Florence Ducommun, photos additionnelles à Avignon